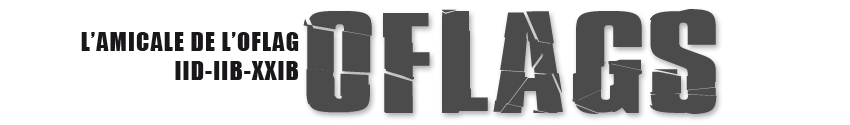La Guerre et la Captivité |
| Le matin de la mobilisation générale, je n'étais pas à l'usine. J'avais demandé le m'absenter pour assister à l'enterrement d'un scout de mon groupe qui venait de mourir brusquement sans que l'on ait su exactement de quoi. L'après-midi, mobilisé, je suis allé quai de Javel, pour faire mes adieux à ceux qui, mobilisés sur place, ne quittaient pas l'usine. A ce moment-là, ma sœur Renée était à Royan avec ses enfants pour les vacances. Mon beau-frère, Jean Stoeckel m'avait demandé, puisque j'étais mobilisé à Bordeaux, au 18° train, d'emmener à Royan, en passant, leur voiture qui était restée à Boulogne. Je suis donc allé la chercher et j'ai roulé toute la nuit, ne m'arrêtant que pour dîner à cette heure où il ne fait pas encore tout à fait nuit mais déjà plus jour. Il était convenu que je passais par Rochefort où je laisserai la voiture pour prendre le train de Bordeaux, après avoir embrassé Maman et Bonne-Ma nan. Renée viendrait la récupérer. Au cours de la nuit, j'avais eu un petit accrochage, sans gravité, n'ayant vu qu'à la dernière seconde un camion arrêté sans éclairage sur le bord de la route. J'arrivai donc à Bordeaux dans l'après-midi. J'étais affecté au Groupe de Transport n° 6 du 1B° Train, à l'état-major où je remplissais les fonctions de chef du peloton de circulation. Les premiers jours ont été occupés par la réception du matériel réquisitionné : autos, camions et, surtout pour moi, motocyclettes, puisque le peloton de circulation est constitué pratiquement entièrement de motards. Je devais aussi recevoir les hommes; affectés à ce peloton et vérifier leurs qualités de motocyclistes ! Pour moi, j'avais repéré parmi les véhicules réquisitionnés - surtout des Citroën - une voiture décapotable que j'ai adoptée car elle me permettait de surveiller plus facilement mon peloton, J'ai d'ailleurs pu conserver cette voiture pendant toute la guerre, ainsi que son chauffeur, Jean Bleynie, qui avait été à Saumur en même temps que moi. Il y était le chauffeur du colonel et je connaissais ses qualités et sa gentillesse. Nous sommes partis de Bordeaux pour le nord-est par petites étapes qui permettaient de roder hommes et matériel Dès le deuxième jour de ce voyage, le colonel, qui n'avait pas apprécié mon plan de circulation pour la traversée de Poitiers, me mutait à la 1° compagnie comme chef de section. La première compagnie était la seule du groupe à être équipée de camionnette et non de camions. C'était la compagnie légère, plus facile à manier et donc la plus souvent utilisée quand les transports demandés n'exigeaient pas des 3,5 ou des 5 tonnes. Le commandant du Groupe, Commandant Degravel, n'était pas encore colonel, mais il était très flatté quand on lui en donnait le titre- ce que nous faisions toujours, bien sûr ! - Il était avant la guerre le commandant du bureau de recrutement de Bordeaux. A la première compagnie, le capitaine, Capitaine Bayle, était un réserviste, dans le civil hôtelier à Chatelaillon et son adjoint, Lieutenant Lecourt, était, lui, hôtelier à Arcachon I Les autres officiers, tous réservistes, étaient Roy, Dageville, Brialix, et Serres. Nous avions souvent à faire à l'atelier du groupe dont le chef était Robert Lapresle, rochefortais, ingénieur des Arts et Métiers, dans le civil directeur des services techniques de la ville de Rochefort. Nous avons d'abord été dirigés vers les environs immédiats de Pont-à-Mousson. C'était la période de la « drôle de guerre » et les quelques missions qui nous ont été confiées nous ont amené tout près des lignes pour y livrer des munitions, mais sans que nous ayons pu nous rendre compte que nous en étions si près ! La seule obligation un peu gênante était de rouler la nuit tous feux éteints. De là, nous sommes partis vers la Champagne et nous avons cantonné quelques semaines sur la montagne de Reims, en vue des flèches de la cathédrale. Ce fut une période très calme, avec pratiquement aucune mission. Notre seul travail s'est réduit à 1'entretien et à la mise au point du matériel.... et aussi à la surveillance du personnel, très tenté par le champagne que l'on pouvait se procurer à des prix sans concurrence ! Puis nous sommes partis pour la région de Boulogne-sur-mer. Période encore très calme, marquée seulement par quelques visites au Touquet dont les grands hôtels avaient été transformés en hôpitaux dans lesquels quelques uns de nos hommes et de nos camarades officiers avaient été hospitalisés, en particulier notre camarade Brialix qui souffrait d'une maladie qui d'ailleurs nécessitera son retour vers l'intérieur. A noter aussi pendant cette période quelques exploits de Robert Lapresle, exploits cynégétiques qui ont apportés des améliorations à notre popote dont j'étais chargé; j'ai beaucoup apprécié les lièvres et faisans que nous apportait Lapresle, mais il faut bien dire que la tâche lui était facilitée par la neige qui a fait son apparition à ce moment, et aussi par le fait que, la chasse n'ayant pas été ouverte cette année-là, le gibier était beaucoup plus facile à approcher. C'est là que nous avons passé les journées de Noël et la fin de l'année. Le curé du village où nous étions logés, était une vocation tardive, un ancien marin au franc parler. Le premier dimanche que nous avons passé dans le village, nous l'avons vu dégager - j'allais dire presque manu militari - le premier banc de son église, pour y recevoir les officiers de la Compagnie. C'est au cours d'une de ces messes que nous avons assisté à plusieurs incidents assez drôles. Tout le monde, savait dans le village, que le sacristain faisait une seconde quête - destinée, celle-là à lui permettre de fréquentes visites à l'estaminet où son premier repas consistait en un café terminé par une « bistouille », mais où il remplaçait l'alcool ordinaire par un Pernod ! Un dimanche, où lors de la lecture de l'évangile - qui à cette époque se lisait dos à l'assistance - les enfants de chœur chahutaient quelque peu ; après avoir tenté en vain de les calmer, le sacristain s'est approché du curé pour réclamer son intervention. Celui-ci, interrompant à peine sa lecture, lui a dit : « Fous moi la paix ! ». Le sacristain insistant, il lui a déclaré tout haut. « Vas-tu me foutre la paix, nom de Dieu ! ». Après quoi, très dignement, il a terminé sa lecture. C'est au cours de ce séjour que notre capitaine Bayle a été, lui aussi, renvoyé à l'intérieur et remplacé par le capitaine Piveteau qui était directeur d'école à Bordeaux. Le déménagement suivant - de courte distance - nous a amené du Pas de Calais vers le Nord, dans la région du Quesnoy et de Pois du Nord. Là, notre station a été plus longue et nos missions plus nombreuses. Comme je l'ai déjà dit, notre compagnie était la compagnie légère, équipée de camionnettes ; elle était donc la plus mobile, utilisée de préférence quand il ne s'agissait que de transports légers. C'est ainsi, par exemple, que pendant quelques temps, ma section a été détachée auprès d'une compagnie de mitrailleurs que nous étions chargés de transporter au cas où les affaires viendraient à se gâter J'ai alors été hébergé à la popote de cette compagnie. Mais, le déclenchement des opérations que l'on craignait avec la venue du printemps, ne s'étant pas produit, j'ai reçu l'ordre de regagner ma compagnie ; il était prévu toutefois qu'à la moindre alerte, je pourrais à tout instant rejoindre ce poste. Depuis quelques mois, aucune opération importante ne se produisant, on avait établi un régime de permissions : à tour de rôle, chacun avait droit à une permission de dix jours. Mon tour vint dans les premiers jours de mai et je suis parti passer quelques jours à Rochefort. Je devais terminer en passant deux ou trois jours à Paris où je retrouvais ma chambre, rue des Poitevins. Il fallait que je la dégage en prévision d'une absence qui risquait d'être plus longue que prévue. Je me suis aussi promené dans Paris qui ne donnait vraiment pas l'impression d'une ville en guerre ! Un soir, je suis allé dîner dans un petit restaurant alsacien du Boulevard Saint Michel où j'avais l'habitude d'aller de temps à autres avant la guerre, et j'ai eu la joie d'y rencontrer Maurice Travers, un des chefs d'équipe de mon clan, frais émoulu de Saint-Cyr où il avait opté pour l'aviation. Nous avons passé une agréable soirée, loin de nous douter que c'était la dernière du genre avant longtemps ! Le lendemain, le l0 mai, se déclenchait la véritable guerre ! Parti immédiatement pour essayer de rejoindre mon unité par un centre de triage - car je ne savais pas si elle n'avait pas fait mouvement pendant ma permission -, je l'ai retrouvé au même cantonnement. Mais ma section n'était plus là, partie pour la mission prévue, sous les ordres du lieutenant Serres, adjoint du capitaine. Nous ne l'avons jamais revue : elle a suivi sa compagnie de mitrailleurs pendant toute la guerre et s'est retrouvée quelque part, dans le midi, échappant ainsi à la captivité. Pour nous, avec ce qui nous restait de matériel, nous avons rempli quelques missions vers la Belgique, assistant au passage au bombardement assez impressionnant de quelques grosses usines belges, dont une importante centrale électrique, près de Mons. Un soir, j'ai vu arriver dans le cantonnement voisin du nôtre, un peloton d'autos mitrailleuses, et, parmi les officiers, mon ami Georges Raymond, Rochefortais, camarade de lycée et qui était aussi à Saumur en même temps que moi. Sous-lieutenant de char, il devait être grièvement blessé le lendemain, et amputé d'une jambe. D'après les nouvelles que j'ai pu en avoir plus tard, il aurait été affecté à la justice militaire et aurait pris sa retraite comme général. Devant l'avance allemande, nous avons dû faire mouvement vers l'ouest, en direction de Dunkerque en contournant Lille par le sud. Mais, au passage des canaux, nous avons été contraints d'abandonner tous nos véhicules et la plus grande partie de nos bagages, et c'est à pied que nous sommes arrivés dans le périmètre de Dunkerque que l'on essayait de sauvegarder afin de maintenir le plus longtemps possible une tête de pont. Nous y sommes restés une huitaine de jours. Ayant récupéré quelques camions abandonnés par les unités, surtout anglaises, déjà embarquées, nous avons pu faire encore quelques transports de matériel, - médicaments pour le sanatorium des Dunes, transformé en hôpital ou munitions pour le fort des Dunes. Celui-ci devait être sévèrement bombardé et nous y avons perçu quelques chauffeurs qui s'y étaient réfugiés, espérant y trouver un abri sûr ! Je me rappellerai longtemps ces quelques transports effectués à travers les rues de Dunkerque en flammes ! C'était, d'ailleurs, une pagaille effroyable. Le ravitaillement n'arrivait plus que par quelques petits bateaux qui parvenaient jusqu'au port. L'eau avait été coupée : nous n'avions plus, pour nous désaltérer, par une très forte chaleur, que les provisions de whisky, heureusement considérables, laissées par les troupes anglaises rembarquées. Il n'était évidemment plus possible d'obtenir une certaine discipline de nos hommes dont la seule préoccupation était de rechercher un embarquement sur des bateaux qui croisaient encore au large des plages et de rejoindre ainsi l'Angleterre. Bien peu y réussirent et parmi ceux-ci, mon chauffeur, Jean Bleynie, avec un de nos sous-officiers, qui avait été un de mes condisciple au lycée de Rochefort, Paul Fouchereaux, fils d'un drapier Rochefortais. Tous deux parlaient couramment l'anglais, ce qui a dû leur faciliter grandement les choses ! Les plages de Bray-Dunes et de Malo étaient couvertes de soldats attendant un éventuel départ. Elles étaient, d'ailleurs, régulièrement mitraillées et bombardées par les avions allemands. Mais c'était surtout les bateaux qui étaient leurs cibles privilégiées; et nous assistions, impuissants, du rivage, au naufrage de ces bateaux bondés de réfugiés dont, souvent les corps jonchaient la plage, le lendemain matin. Enfin, le 3 mai, au soir, nous avons reçu l'ordre de rejoindre la jetée Est de Dunkerque où nous devions être embarqués à notre tour, dans la nuit, sur des bateaux qui nous emmèneraient en Angleterre. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'un accord était intervenu avec les Allemands concernant la reddition de Dunkerque ce soir-là, à minuit, et que tout embarquement devrait cesser à cette heure-là. Effectivement, à minuit, très exactement, les Allemands envoyaient en direction de la jetée, un obus, un seul, pour marquer la fin de cette tolérance. Heureusement cet obus est tombé à coté de la jetée, mais à la hauteur du groupe dont je faisais partie : il y eut quand même quelques morts, dont notre motard qui était monté sur le parapet pour voir si les embarquements progressaient : il a dû basculer dans l'eau ! Pour ma part j'avais eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Lapresle, qui se trouvait à coté de moi, m'a dit de regarder si je n'avais pas une plaie. Il n'y avait rien. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que je me suis aperçu que mon ceinturon - qui à cet endroit, présentait une double épaisseur -, avait été percé et j'ai retrouvé, dans la poche de ma capote l'éclat d'obus qui, sans mon ceinturon, m'aurait atteint au ventre. Le lendemain matin, nous sommes revenus dans nos cantonnements provisoires. Des drapeaux blancs flottaient partout : nous n'avions plus qu'à attendre l'arrivée des allemands : nous étions prisonniers ! Tout d'abord, en immenses colonnes, par cinq, - comme nous aurons souvent l'occasion de l'entendre par la suite, - nous avons été dirigés, sans aucune distinction de grade ou d'unités, vers la Belgique, et installés plus ou moins bien, dans une usine de filature de Roulers. Là, au moins, l'eau n'était pas coupée et nous avons pu nous laver. Nous y sommes restés deux jours avant de repartir, en camions cette fois, vers la Hollande, par le tunnel sous l'Escaut, à hauteur d'Anvers. Nouvel arrêt de quelques jours avant d'être embarqués à nouveau pour un camp des environs de Stuttgart, simple camp de triage avec des installations très rudimentaires. Nous étions parqués en plein champ, et nous avons subi un orage épouvantable, la foudre ayant même tué quelques soldats qui avaient eu l'imprudence de conserver sur la tête leur casque métallique. Là, nous avons été séparés : officiers d'un coté, sous-officiers et hommes de troupe de l'autre. Je ne sais si les Allemands avaient conservé un certain respect de l'officier, mais toujours est-il que nous avons été transportés cette fois par chemin de fer, et en voitures de voyageurs (ce n'a pas été le cas pour tous) vers l'est. Et c'est ainsi que, le 25 ma, nous avons traversé un Berlin en liesse et pavoisé : l'armistice avec la France venait d'être signé. Le lendemain, nous arrivions à Gross-Born. Le camp se présentait sous la forme d'un grand quadrilatère de 2 à 300 mètres de coté, délimité par une double rangée de barbelés, avec un mirador à chacun des angles. Le portail d'entrée donnait sur une grande esplanade bordée à gauche par les services administratifs : direction, cuisines, service de la poste et du courrier, infirmerie, prison, etc... Au fond de cette esplanade, un grand bâtiment servait de salle de réunion, de cantine et de salle de spectacle car il possédait une scène assez bien équipée : rampes, herses, portants etc.... De chaque côté, les blocks au nombre de trois au début, portés à quatre par la suite, après la construction de cinq grandes baraques. A droite, les blocks II et III étaient déjà occupés par des contingents d'officiers prisonniers arrivés deux jours avant. A gauche, le « block » I nous attendait. Chacun de ces blocks était disposé à peu près de la même façon : une vingtaine de baraques autour d'un espace central où se déroulait, parfois plusieurs fois par jour les cérémonies des appels. Autour, une étendue de sable, sans un arbre, s'étendait jusqu'aux barbelés ; c'était là tout notre espace vital, dans lequel nous déambulions longuement en faisant le tour de notre block, ou, lorsque le temps le permettait, nous nous allongions sur le sable. Au nord, le camp était adossé à une immense forêt qui devait s’étendre jusqu'à la Baltique, à cinquante ou soixante kilomètres de là : nous nous trouvions dans d'excellentes conditions sanitaires. Au sud la plaine poméranienne, légèrement en contrebas s'étendait jusqu'à l'horizon, simplement piquetée de quelques fermes. A l'origine, les blocks étaient séparés : pour passer de l'un à l'autre, il fallait un motif précis et être muni d'une autorisation et d'un laissez-passer, un « ausweiss ». Le block I, le nôtre, qui était le plus grand et qui disposait de beaucoup plus d'espace, fut très rapidement doublé, après la construction de nouvelles baraques, par l'arrivée de camarades qui avaient été logés provisoirement dans une caserne située à quelques kilomètres, et qui ont alors formé le block IV . La baraque-type était en bois, constituée de quatre chambres : dans chacune de ces chambres, cote à cote, des châlits à trois étages. Au centre, deux tables quatre bancs, une dizaine de tabourets et un poêle qui pouvait être chauffé soit au bois soit au charbon, tous combustibles d'ailleurs assez rares et qui nous étaient distribués avec beaucoup de parcimonie ! Nous étions là-dedans une trentaine, c'est dire que l'espace individuel était des plus restreint. Pour gagner sa place, dans son châlit, il fallait s'y glisser par la petite extrémité et l'on disposait alors d'un emplacement qui mesurait environ deux mètres de long, cinquante centimètres de large et soixante-dix centimètres de haut. Ceci était la situation dans les premières semaines de la captivité : nous étions alors quelques six mille officiers dans le camp. Mais cette situation n'a duré que quelques temps. Certaines catégories ont quitté le camp - soit pour être regroupées ailleurs (les aspirants, les ecclésiastiques ou les Alsaciens et Lorrains, par exemple) - soit pour être libérées plus ou moins rapidement (les réservistes anciens combattants, les sanitaires, les soutiens de famille ou ceux qui étaient réclamés par leur société réquisitionnée par les Allemands). Ces départs ont considérablement diminué l'effectif et donc la concentration dans les chambres où nous avons pu desserrer les châlits en établissant un petit couloir entre chaque groupe de deux, nous ménageant ainsi un accès à notre domaine par le coté. Dans chaque « block », on avait pu aussi dégager une ou deux baraques qui, libérées de leurs cloisons intérieures, purent servir de salles de conférence ou de chapelle. Au bout de quelques semaines, nous avons pu jouir aussi d'un peu plus de liberté en ce sens que, dans la journée, nous avons été autorisés à circuler d'un block à l'autre et à retrouver ainsi des camarades qui étaient dans les autres parties du camp . Je ne m'étendrai pas sur la vie que l'on peut mener dans un camp d'officiers prisonniers : d'autres l'ont fait et beaucoup mieux que je ne pouffais le faire. L'abbé Flament a écrit sur ce sujet une volumineuse thèse et un certain nombre de romans ou de récits publiés après la guerre l'ont racontée :sans les nommer tous, il faut citer ceux d'Armand Lanoux ( Le commandant Watrin), de Paul-André Lesort (La vie de Guillaume Perier et Partage de la mémoire), de Roger Ikor (Pour une fois écoute, mon enfant), de Jean Ratinaud (Le Radeau de la Méduse) Je vais me borner donc à quelques souvenirs personnels. Au début, notre chambre était sous la responsabilité du capitaine le plus ancien ; il était de notre groupe : c'était le capitaine Piveteau. Mais, au bout d'un certain temps, les services généraux du camp se sont organisés et Piveteau a été chargé du service de la poste. C'est un capitaine d'artillerie d'active qui l'a remplacé, Larrouy. Nous nous étions réunis en cinq ou six popotes, plus ou moins homogènes et indépendantes. La mienne comprenait quelques fortes personnalités : deux jeunes polytechniciens, Jacques Benezit et Jacques Vasseur, le premier ingénieur des Mines et le second des Ponts et Chaussées, un futur jésuite, Paul Haubtmann, stéphanois, et trois tringlots : François Huet qui a été rapatrié comme soutien de famille (il était 1'aîné de huit enfants et son père était décédé), Jacques Faure, de loin notre doyen, représentant de Renault à Bordeaux, et moi. Bientôt, s'est agrégé à nous Paul Benoist dont la sœur avait épousé mon camarade de Centrale, Gilles Renaud, et qui, dès avant la guerre et bien que lui môme sorti d'HEC, avait suivi les activités du clan de Centrale. La moyenne d'âge était de 25 ou 26 ans et nous mettions une certaine animation dans la chambre, au point qu'un jour notre chef de chambre, Larrouy, un peu agacé, a traité la popote de « groupe de foutriquets ». Nous avons Adopté ce sobriquet comme un titre de gloire et, désormais, nombre de nos camarades du camp ne nous ont plus appelé que les « foutriquets ». L'effectif de cette popote a beaucoup évolué : les deux polytechniciens ont été rapatriés comme ingénieurs de l'Etat ; François Huet est parti comme aîné de famille nombreuse. Je crois que c'est à ce moment que nous avons adopté Henri Loup, qui était un de mes anciens de Centrale... et la popote n'a plus guère évolué, du moins pendant le reste de notre séjour à Gross-Born. Petit à petit, le camp s'est organisé. Des six mille officiers, environ, qu'il comptait dans les premières semaines (en y incluant ceux qui ont formé le block IV) il en est parti un bon nombre. Les aspirants, que les Allemands hésitaient à considérer comme officiers, sont allés former un camp particulier en Prusse Orientale. Des ecclésiastiques, ne nous sont restés que ceux qui s'étaient déclarés professeurs, lors du premier contrôle. Heureusement pour nous ! Ii n'est resté, comme aumônier officiel que le Père Dupaquier ; un bon curé bourguignon ; aumônier divisionnaire, il avait refusé de partir avec les « sanitaires » et avait gardé son franc-parler, aussi bien avec ses « ouailles » qu'avec les autorités allemandes dont il était quelque peu craint. Sont également partis les alsaciens et lorrains à qui il était proposé un engagement dans la Wehrmacht. Nous sommes donc restés entre trois et quatre mille, et parmi ceux-ci se sont révélés des personnalités qui, rapidement, ont été mises à contribution. La convention de Genève interdit le travail des officiers s'ils ne sont pas volontaires ; les Allemands, bien sûr, ont essayé de recruter un certain nombre d'entre nous pour qu'ils acceptent d'aller travailler, en leur faisant miroiter de nombreux avantages, mais sans grand succès, il faut bien le dire. Nous étions donc libres de notre temps sinon de notre espace. Nous n'étions astreints qu'à un ou plusieurs appels quotidiens - dont les heures variaient d'ailleurs -, et, le soir, nous devions être rentrés dans les chambres à une heure également variable selon la saison. A part cela, nous avions la possibilité de déambuler, comme nous l'entendions à l'intérieur du périmètre des barbelés, au début seulement dans notre « block », puis après quelques semaines, dans l'ensemble du camp. Pendant ces premières semaines, et même ces premiers mois, on a donc des officiers prisonniers, par groupe de deux ou trois, faisant indéfiniment le tour de leur espace vital, discutant sans fin de ce qu'ils avaient vécu, des perspectives, du développement de la guerre:.. etc. Avec l'expérience des premières semaines de la guerre, tous étaient persuadés, les Allemands comme nous d'ailleurs, que la guerre ne pouvait s'éterniser : les plus optimistes se voyaient chez eux à Noël ! Et puis, petit à petit, nous sommes revenus de nos illusions et l'on a commencé à s'organiser sérieusement pour une longue période. Il y avait, parmi nous des professeurs de toutes les disciplines, des musiciens, des spécialistes capables de faire des conférences sur les sujets les plus variés. C'est donc par des conférences que tout a commencé. J'ai dit que, dans chaque « block », quelques chambres avaient été libérées et c'est là que furent données les premières. Bientôt, à la porte de ces pièces, fut affiché le programme, et, à certaines heures – si du moins ce programme n'était pas bouleversé par un appel inopiné -, or pouvait voir des files de prisonniers, portant sur leur tête leur tabouret, les pieds en avant, comme des espèces de cornes, se diriger vers les salles de conférences. Celles-ci couvraient tous les domaines : des professeurs de faculté parlaient de leur discipline ; des officiers de carrière parlaient de leurs expériences souvent coloniales ; des anciens élèves de grandes écoles venaient raconter leur école ; des prêtres traitaient de sujets religieux.... Il faut ici signaler que ces chambres libres ont été aussi tout de suite utilisées, en particulier, comme lieux de culte. Chaque dimanche y étaient célébrées plusieurs messes, car nos prêtres, ou du moins certains d'entre eux avaient pu sauver, dans la débâcle leur autel portatif. De même, chaque matin, des messes y étaient dites, en attendant que soient construits par nos architectes de véritables autels, sinon des chapelles. Les blocks I et IV n'étaient pas séparés et c'est là que notre camarade Crouzillard, architecte, avec du contreplaqué, du carton, des morceaux de bois, a construit la plus belle, une véritable église romane. Avec des papiers de couleur des camarades ont dessiné et réalisé des vitraux. Et des boites de conserve ont été très artistiquement transformées en porte-cierges ou en encensoir ! La splendeur de l'édifice était telle que lorsque les Polonais nous ont remplacé à Gross-Born, ils l'ont immédiatement baptisée « la Cathédrale » ! Puisque nous parlons de la pratique religieuse au camp, il faut dire qu’elle elle était. Les aumôniers divisionnaires ont été libérés avec les « sanitaires », à une notable exception. La plupart des prêtres, au premier interrogatoire, s'étaient déclarés comme tels : ceux-là ont été assez rapidement regroupés dans un camp spécial et ont dus quitter le nôtre. Il ne nous est resté qu'une quinzaine de prêtres qui avaient eu l'idée de se déclarer professeurs, ce qu'ils étaient, d'ailleurs, dans des institutions religieuses. Le seul aumônier divisionnaire qui avait refusé de partir, était l'abbé Dupaquier, curé dans une paroisse de Bourgogne dont il avait gardé l'accent. Ses titres d'aumônier et d'ancien combattant, lui auraient permis d'être rapidement libéré. Il a préféré rester parmi nous pendant les cinq années, prisonnier volontaire et aumônier non seulement de notre oflag, mais aussi des quelques stalags voisins. Il n'est pas un de nos camarades qui ont écrit, après la guerre, des livres où ils aient fait allusion à la captivité, - même des athées notoires - qui n'ait couvert d'éloges cet aumônier qui a toujours su, en face des Allemands qu'il gênait beaucoup, conserver une attitude de fermeté qui les impressionnait. Ne quittons pas ce chapitre sans évoquer aussi la messe de Noël 1940. Je n'y ai pas assisté puisqu'à cette époque, les « blocks » étaient encore isolés. Elle a été célébrée au block II, dans la grande salle des fêtes du camp, par Dom Sortais, abbé de la Grande Trappe, aumônier divisionnaire, et encore prisonnier au camp, avant son rapatriement avec les « sanitaires ». Ce fut donc une messe pontificale et il a fallu, avec les moyens du bord, fabriquer une crosse et une mitre, sans parler du luminaire, de l'encensoir, des burettes, etc.... Elle a laissé un souvenir inoubliable à ceux qui ont pu y assister ! Et puis, la captivité dépassant les limites espérées, les conférences se sont transformées en véritables cours. Les professeurs de faculté ont organisé une Université où furent donnés des cours de langues d'abord, (l'allemand surtout, bien sûr) puis des cours de droit, de littérature, de sciences, de géologie... Des examens pouvaient être préparés et passés, les professeurs se faisant fort de faire valider ces examens à notre retour en France. C'est ainsi, par exemple, que François de Testa a pu préparer le concours des Affaires Etrangères au camp. C'est ainsi aussi que nous avons eu un grand séminaire où une quinzaine de nos camarades, sous la direction des prêtres du camp, ont pu reprendre ou entamer leur préparation au sacerdoce. Les musiciens ont pu faire venir ou acheter sur place des instruments et il s'est formé plusieurs orchestres, dont un grand orchestre symphonique d'une trentaine d'exécutants, quelques petites formations de musique de chambre - entre deux et six membres -, des orchestres de jazz ou de musette. Nous avions même, dans les derniers mois une formation style Ventura. Très rapidement aussi, on a pensé au théâtre, d’autant plus que nous disposions d'une salle très bien équipée. Mais, au début, nous manquions de textes et les premiers essais ont été des improvisations qui tenaient plus du feu de camp ou du crochet radiophonique que de la Comédie Française. Petit à petit, la mémoire de certains et, surtout la réception, de textes ont permis le montage de véritables spectacles. Ainsi notre block I a pu jouer « Le médecin malgré lui » qui a été, je crois, la première pièce donnée au camp. J'y jouais Léandre et André Delorme s'essayait dans le rôle de Lucile, car il fallait bien que les rôles féminins soient tenus par des garçons ! Chaque block a alors constitué sa troupe théâtrale sous la direction d'un ou deux metteurs en scène. Le plus prestigieux d'entre eux a été incontestablement celui du block II, l’abbé André Sochal, que nous appelions affectueusement « Monseigneur », professeur au Collège Saint Paul à Angoulême, et qui animait à la fois l'aumônerie et la troupe théâtrale du block II. Mais je consacrerai un chapitre particulier à cette question du théâtre. Une de nos plus grandes activités a été la lecture. Ce qui, au moins au début, a posé quelques problèmes. Car, évidemment, nous manquions de matière première. Ceux d'entre nous qui connaissaient l'allemand pouvaient au moins disposer des journaux locaux dont ils donnaient la traduction à leurs camarades de chambre ; mais les livres qui circulaient étaient très rares tant que nous n'avons pas pu en recevoir. On a donc pensé à constituer aussi rapidement que possible une bibliothèque : la solution adoptée, très simple en fait, a été la suivante : tous ceux qui recevaient dans un colis, un livre, après l'avoir lu et fait lire à leurs camarades de chambre, le versait au fond commun. Et c'est ainsi que s'est constituée une bibliothèque qui a pu prendre une relative importance. Pendant notre séjour à Gross-Born, l'organisation est restée assez rudimentaire et ce n'est qu'après notre installation à Arnswalde, où une grande pièce a pu lui être affectée, qu'elle a pris toute son importance puisque, tous blocks confondus alors, son effectif a largement dépassé les 10000 volumes. Malgré la faiblesse de calories de nos rations alimentaires, le sport a tout de même tenu une certaine place dans les activités de certains. A Gross-Born, sans parler de la marche qui a été le sport pratiqué par tous, certains se sont essayés au football et à l'éducation physique. Mais, pour les sports qui demandent du matériel, ils n'ont pu être pratiqués que plus tard et surtout à Arnswalde. Mais là, grâce à la présence d'un grand gymnase, nous avons pu assister à des matches de volley, de basket, de pelote basque et même de tennis ! Lorsque j'ai parlé de la musique, j'ai oublié de signaler la constitution de plusieurs chorales - au moins une par block - dont l'activité principale a été l'accompagnement des messes dominicales, mais qui nous ont aussi donné quelques beaux concerts ! Ainsi, petit à petit, nous nous sommes arrangés pour meubler nos loisirs forcés par des cours, des promenades et un peu de travaux culinaires, du moins après que nos popotes aient pu être ravitaillées par les colis reçus de nos familles, et qui, à part les objets personnels - assez rares, d'ailleurs, étaient entièrement versés à la communauté. Evidemment, le contenu de ces colis étaient très variés et très différents selon leur origine : zone libre ou zone occupée, ville ou campagne et aussi selon les possibilités de ravitaillement des expéditeurs. Au début, leur envoi était libre, et chacun d'entre nous, ignorant les difficultés que nos familles rencontraient en France, essayait de les multiplier. Je me rappelle ainsi, espérant doubler le nombre de colis qui pouvaient m'être adressés de Rochefort, avoir écrit à Maman que Bonne Maman pouvait aussi m'en envoyer ! Maman n'a pas vu l'allusion et m'a répondu que l'âge de ma pauvre Grand-Mère qui devait d'ailleurs mourir quelques semaines plus tard, ne lui permettait plus de les confectionner elle-même. D'ailleurs, bientôt, les expéditions ont été réglementées : ne pouvaient être envoyés que des colis portant une étiquette envoyée par nous et qui ne nous était accordée qu'à raison d'une, quelquefois deux par mois. Il en était de même pour les lettres pour lesquelles nous recevions, deux fois par mois, un formulaire dont le coté gauche était destiné à la lettre elle-même et le coté droit à la réponse. Toute autre correspondance était interdite. Très rapidement, d'abord par block, puis dans l'ensemble du camp, nous nous sommes regroupés par affinités, dans mon cas, les Centraux et les scouts. Ma promotion de Centrale était très largement représentée et je suis sûr que j'en oublierais si je voulais citer tous ceux de mes camarades qui partageaient mon sort. Je me contenterai de ceux dont j'ai été le plus proche et que, pour la plupart, je connaissais bien dès avant la captivité : tout d'abord, Pierre Jourde qui était déjà avec moi à Stan, et dans ma turne pendant nos trois années d'école, et puis, - je cite au hasard - Armand, Reinaud, Chamoin, Hibon, Mégueil, Bonvarlet... avec une mention toute spéciale pour Jean Stickzinski qui, lui, a été rappelé par sa société, qui a fait de la résistance et qui est tombé dans un guet-à-pens où il a été tué par les Allemands. C'est, d'ailleurs notre promotion qui avait été chargée de présenter l'Ecole Centrale à nos camarades de captivité dans une conférence que nous avons faite à trois, l'un d'entre nous y donnant une fort bonne imitation de quelques uns de nos professeurs. Nous avons aussi, dans notre block comme dans les autres, mis sur pied un clan routier. Nos activités étaient évidemment assez réduites : quelques réunions, des soirées de prière, mais aussi la préparation de spectacles destinés à divertir un peu nos camarades ; un exemple : une soirée, nous avons pu jouer deux petites pièces du répertoire des Comédiens Routiers - d'ailleurs avec les conseils de l'abbé Sochal -. L'une d'elle, s'intitulait - ce qui était plein d'ironie, dans les conditions particulières où nous nous trouvions – « Les méfaits de la Gulosité ». Nous avons aussi pu mettre une certaine animation dans le camp : j'aurai l'occasion d'en reparler. Je reparlerai aussi plus tard d'une des activités à laquelle je me suis beaucoup consacré : le théâtre. J'ai déjà dit que, dans chaque block s'était créée une troupe. J'ai dit aussi que la grande salle de la cantine, au centre du camp, était bien équipée et c'est ainsi que, à tour de rôle, chaque block donnait un spectacle pendant cinq jours de suite : un soir pour chacun des blocks et un soir pour la compagnie d'ordonnances. Nous avions donc ainsi, pratiquement, une soirée théâtrale chaque semaine. Nous avons passé comme cela presque deux années sur le sable, à l'orée de cette grande forêt, qui cernait le camp sur trois cotés, le quatrième ouvert sur la campagne poméranienne, où quelques fermes sans grande activité et un petit lac ne nous apportaient guère de distractions ! La vie y était très monotone ; aussi les quelques événements particuliers qui se produisaient, prenaient-ils d'autant plus de relief. Ce fut d'abord les départs dont j'ai parlé et qui, bien sûr, étaient toujours accompagnés de bobards concernant la libération générale prochaine. Evènements tristes aussi, quelques décès dont le premier a été celui d'un de nos camarades de chambre, ancien de notre groupe, Sabourin, cultivateur en Charente qui n'a pas résisté aux restrictions auxquelles nous étions soumis. Le cimetière avait été établi, juste à coté de notre block, à l'ouest du camp. A chaque enterrement - heureusement, ils n'ont pas été nombreux - quelques uns de nos camarades, les plus proches du mort, précédés de l'aumônier, accompagnaient le cercueil jusqu'au cimetière, beaucoup d'autres assistant, silencieux, près des barbelés extérieurs, à l’inhumation de leur camarade. Dans la forêt, assez loin de notre camp pour que nous ne puissions le voir, les Allemands avaient établi un autre camp destiné aux prisonniers russes. Mais la gare, où s'arrêtaient les convois de prisonniers, était en vue de notre camp et, après le début de la campagne de Russie, nous avons assisté, presque journellement, à l'arrivée de groupes de prisonniers : de chaque wagon, après la sortie des quelques survivants, on extrayait des wagons les cadavres de ceux qui n'avaient pas supporté le voyage. Le cimetière des Russes était à coté du nôtre. Chaque jour, nous pouvions ainsi voir arriver vers ce cimetière, d'étranges convois : des charrettes accompagnées par des « posten » indifférents ; quelques russes, tout aussi indifférents, venaient déverser dans de grandes fosses communes, les cadavres entièrement nus des morts qui avaient été dépouillés par leurs compagnons et qui étaient enterrés sous une couche de chaux vive et de terre. Ce spectacle, pratiquement quotidien, n'a pas manqué de susciter, parmi les officiers français, une vive réprobation et de provoquer des mouvements divers. Les Allemands, après avoir tenté de nous tenir éloignés de la clôture en menaçant des mitraillettes des miradors, ceux qui s'approchaient trop près des barbelés ou qui y stationnaient trop longtemps en manifestant hautement leur réprobation, ont été obligés d'expliquer que ces mesures étaient nécessitées par une épidémie de typhus dans le camp russe – En tous cas - protestations des Français ou saturation du cimetière russe ? - nous n'avons plus eu à subir cette vision quotidienne. D'autre évènements, relativement fréquents à Gross-Born, ont été les évasions ou les tentatives d'évasion. Nous étions sur le sable, à proximité d'une grande forêt. Donc, la tentation était grande de creuser, à partir du sous-sol des baraques, des tunnels vers la forêt. Mais ces tunnels devaient avoir parfois plus de cent mètres et leur creusement posait de nombreux problèmes dont les principaux étaient l'évacuation des déblais, l'aération des travailleurs et, évidemment l'alerte à donner en cas d'appel ou de fouille inopinés. Pour ma part, je n'ai pas participé au creusement de tunnels ; je me suis contenté d'abandonner aux mains des tailleurs ceux de mes vêtements qui pouvaient, moyennant quelques transformations, fournir des vêtements civils. Le tunnel a donc été le principal mode d'évasion utilisé à Gross-Born, mais il n'a pas été le seul. Pour assurer une partie du chauffage de nos baraques, nos gardiens nous ont autorisé à organiser des corvées qui, sous la surveillance de quelques sentinelles, allaient en forêt arracher quelques vieilles souches, ensuite distribuées dans les chambres. Au cours de ces corvées, il était relativement facile à un ou deux participants, parlant allemand, de détourner l'attention des sentinelles afin de permettre à ceux de leurs camarades qui s'y étaient préparés de s'esquiver. Le problème était de tromper les gardiens au départ en obtenant un compte inférieur au compte véritable, pour masquer, au retour le manque de participants. En fait, bien peu d'évasions ont été couronnées de succès. Dans la plupart des cas, les évadés étaient repris après quelques jours et étaient reconduits au camp pour y purger une peine d'une quinzaine de jours de prison avant de reprendre leur place parmi nous Mais il faut tout de même parler de deux évasions qui ont beaucoup marqué. La première fut celle, au cours d'une séance de déssouchage, de trois officiers qui ont pu rejoindre la Russie, et par là la France Libre. Parmi eux, celui qui sera le général Billotte. Une autre évasion, en mars 1942, a fini tragiquement. Elle avait été préparée par le creusement d'un très long tunnel qui, partant du sous-sol d'une baraque de notre block, aboutissait dans la forêt bien au delà des barbelés. Le tunnel devait servir plusieurs jours de suite. Le premier jour, tout s'est bien passé : la première sortie s'est produite sans incident. A la nuit suivante, un nouveau groupe s'est introduit dans le boyau, mais les Allemands, entre temps, avaient découvert l'extrémité du tunnel et le premier évadé a été accueilli par une salve et grièvement blessé : il est mort quelques heures après : c'était le lieutenant André Rabin. Les autres membres du groupe ont pu se dégager avant que la patrouille allemande n'ait investi le block pour découvrir l'entrée du souterrain. Inutile de préciser que les appels des jours suivants ont été quelque peu houleux et ponctués de cris d' « assassins ». En mai 1942, le bruit a couru dans le camp, d'un transfert probable. Nous allions être déplacés et installés dans un camp « plus confortable ». En fait, il semble bien que, le terrain sableux étant très propice au creusement des tunnels, les Allemands aient préféré nous loger dans une caserne désaffectée. Les officiers prisonniers polonais qui l'occupaient jusqu'alors, viendraient nous remplacer à Gross-Born. Effectivement, l'échange a été fait en plusieurs jours : Les occupants des blocks II et III sont venus bivouaquer une nuit dans les blocks I et IV, et leur camp a accueilli un premier convoi de Polonais. Ils sont partis pour Arnswalde et, le lendemain, un second convoi de Polonais venait prendre possession des blocks I et IV dont les locataires étaient dirigés à leur tour vers le nouveau camp. L'accueil que nous avions réservé aux officiers polonais a été enthousiaste et a donné lieu à des manifestations de sympathie qui n'ont pas été du goût de nos geôliers et qui ont, d'ailleurs surpris aussi les nouveaux arrivants eux-mêmes. Cela n'a pas contribué à améliorer nos relations avec nos gardiens - d'autant plus que cette migration a coïncidé à peu près avec les « sanctions » dont les allemands, en dépit de la convention de Genève, ont marqué, dans leur mauvaise humeur, la réussite de l'évasion du Général Giraud. Pendant quelques mois, chez nous comme dans les autres camps, ont été supprimées toutes les « facilités » qui nous étaient accordées : plus de manifestations musicales ou théâtrales, plus de bibliothèque ; cours et conférences étroitement surveillés, sévérité accrue dans la fouille des colis, augmentation du nombre et de la durée des appels, etc… C'est dans ce climat que nous avons découvert notre nouvelle résidence. Notre nouveau domaine était totalement différent de ce que nous avions connu à Gross-Born. C'était une caserne qui avait été occupée par une unité motorisée. Elle était composée de quatre bâtiments de trois étages, plus un étage de combles, disposés autour d'une grande esplanade, deux par deux. Au nord, une grande salle, le gymnase, servait aussi de salle de jeux et d'église. A coté de l'entrée du camp, les bâtiments administratifs - les services de la poste, les cuisines et le réfectoire qui fut rapidement transformé en salle de lecture et de travail - fermant le coté sud du quadrilatère. A l'est, deux suites de garages ont servi, l'une de logement pour quelques officiers et à la compagnie d'ordonnances, et l'autre pour la construction d'une nouvelle salle de concerts et de théâtre. Cette salle, contrairement à ce que nous avions auparavant, a dû être entièrement construite et équipée. Dans chacun des bâtiments, il y avait des caves, utilisées comme salles de répétition ou d'exercice, surtout par les musiciens. C'est ainsi qu'un jour, un appel s'est prolongé très longtemps : il manquait un prisonnier... Il manquait un prisonnier, jusqu'à ce que quelqu'un entende le son mélodieux d'une flûte provenant d'une cave : notre ami Rolland - Louis Francis en littérature - romancier et flûtiste à ses heures, pris par son art, n'avait pas entendu le clairon qui nous convoquait à l'appel ! Dans les couloirs de ces sous-sols, le soir, les popotiers se retrouvaient autour de leurs « schubinette », pour composer le dîner de leurs camarades. La « schubinette » était un petit fourneau fabriqué à partir de vieilles boites de conserve en tôle qui devait être alimenté par de petites boulettes de papier-journal, comme combustible. Le rendement calorifique était extraordinaire : en dix minutes, environ on faisait bouillir un litre d'eau. Elles tenaient leur nom du camp de Schubin où elles avaient été inventées par un prisonnier génial, et d'où elles nous étaient arrivées, ramenées par des camarades à l'occasion d'un changement de camp. Dans les combles, nous disposions d'un certain nombre de salles de tailles variées et qui ont trouvé des affectations diverses. C'est là, dans le comble du block IV que fut rassemblée la bibliothèque (quand les Allemands nous en ont rendu l'usage). Je crois qu'elle devait contenir plus de dix mille volumes, tant romans que livres d'étude, et elle a été l'une de nos meilleures distractions : j'y ai découvert, entre autres les « Hommes de bonne volonté », de Jules Romain et « Autant en emporte le vent ». Elle était ouverte tous les après-midi et chacun pouvait y emprunter un ou deux livres et même retenir à l'avance ceux qui n'étaient momentanément pas disponibles. D'autres salles servaient de salles de cours, d'ateliers pour certaines activités, de salles de répétitions. Une des plus grandes a même pu être transformée en théâtre-miniature, car, l'hiver, le théâtre construit dans les garages était très froid ! Dans le comble du block I, un petit oratoire était toujours accessible. La partie des bâtiments où se trouvaient les chambres était constituée, pour chaque block, par trois étages traversés dans toute leur longueur par un grand couloir que nous arpentions, le soir, après la fermeture des portes, quand nous étions consignés à l'intérieur des blocks. Sur ce couloir donnaient les chambres, de taille variable et où logeaient de 5 à 15 prisonniers, dans des châlits à deux étages. Aux extrémités du couloir, il y avait des sanitaires et, au milieu une pièce de lavabos. Vers le milieu du bâtiment l'espace d'une chambre était ouvert et pouvait être utilisé à diverses fins : appels individuels avec présentation de la plaquette que, en principe chacun devait toujours porter sur lui, salon de coiffure intermittent, salle de ping-pong, etc… C'est aussi dans cet espace, au rez-de-chaussée de notre block - où se situait l'infirmerie - qu'était dite chaque dimanche matin, une messe à l'intention des malades qui, d'ailleurs, n'étaient pas les seuls à y assister. A ce même étage, une petite chambre était occupée par nos abbés Bruneau et Villacroux et leurs popotiers : Paul Haubtmann et François de Testa. Nous avions donc quitté des baraques en bois, mal chauffées, mais aérées et dans un grand espace de sable jouxtant la forêt pour une caserne de pierre, assurément mieux chauffée, mais dans un espace infiniment plus exigu. Le décor végétal de Gross-Born avait été remplacé par un ensemble entièrement minéral, situé à la lisière de la ville. L'atmosphère fut dès lors très différente. Nous avons senti de grands changements : la séparation des blocks - devenue d'ailleurs fictive - avait complètement disparu. Tout était unifié : cours, conférences, bibliothèques, services religieux. Au lieu de quatre blocks, il n'y avait plus qu'un seul camp. D'autres amitiés se sont nouées, car bien que les bâtiments fussent fermés chaque soir - en principe à la tombée de la nuit - avec même l'interdiction d'ouvrir les fenêtres du rez-de-chaussée -, toute la journée, par contre, ils étaient ouverts, ce qui permettait visites et activités communes, qu'elles soient intellectuelles (travail, cours, répétitions théâtrales) ou physiques (sports, compétitions). Car le sport avait pris une grande place avec la possibilité que nous avions maintenant de nous procurer - soit par envois de France, soit par achats sur place - les accessoires nécessaires ; ballons, raquettes et balles de tennis, pelote, etc… Chaque dimanche après-midi, en particulier, dans le grand gymnase où, le matin, avait été célébrée la grande messe, se déroulaient des compétitions de tennis, de volley-ball ou de pelote basque. Le football a été rapidement délaissé (car l'esplanade centrale, empierrée ne s'y prêtait vraiment pas !). Malheureusement, assez rapidement, la raréfaction des colis et la diminution des rations alimentaires qui s'en est suivi, nous ont privé de ces manifestations, qui demandaient trop de calories. Puisque nous parlons de rations alimentaires, il faut évoquer une organisation très originale que nous devons à notre camarade Jean Glottin, président à Bordeaux de « Marie Brizard ». Avec deux ou trois amis, dont Alexandre, qui dirigeait à Paris une agence de publicité, dès avant notre départ de Gross-Born, ils avaient mis sur pied un organisme d'entre-aide qui permettait à chacun, par échanges, de se procurer ce dont il avait besoin ; l'unité de compte était la cigarette. Evidemment les non fumeurs étaient très avantagés, mais ils en faisaient profiter leur popote. Ainsi ont pu s'échanger vêtements, nourritures, boites de conserve, chocolat surtout. Cette organisation a pris le nom de « Centre d'entraide ». Elle s'est considérablement développée à Arnswalde où une pièce des combles du block II avait été mise à sa disposition. Mais non contents de se contenter des échanges individuels, les organisateurs ont voulu faire beaucoup mieux. Bien qu'excellent, le rendement de la « shubinette », était tout de même insuffisant quand Il s'agissait de cuire des légumes secs, par exemple les haricots qui nous parvenaient dans les colis. Jean Glottin a pu obtenir alors des autorités allemandes, que les cuisines de la caserne, qui ne servaient pas l'après-midi, puissent être utilisées par nous et, ainsi, ont pu être préparés lentilles, haricots et autres pâtes. Le système était très simple : chaque popote versait ses arrivages au Centre d'Entraide qui lui délivrait des bons. Chaque jour le popotier indiquait son nombre de rationnaires, sans qu'on puisse savoir à l'avance le menu du jour, car il avait été constaté que les légumes secs avaient beaucoup plus de succès que les nouilles. Vers quatre heures de l'après-midi, une procession de popotiers se rendait aux cuisines chercher ses rations. Cette organisation a fonctionné pendant presque tout notre séjour à Arnswalde : elle n'a disparu que lorsque la pénurie de colis a atteint nos sources d'approvisionnement. Mais le Centre d'Entraide ne s'est pas arrêté pour autant et il s'est transformé en un service d'aide et de secours. Déjà, au camp, nous lui versions une cotisation dont une partie était transférée en France par un mécanisme qu'il serait trop compliqué d'exposer, par l'intermédiaire de la société « Marie Brizard ». Celle-ci se chargeait d'envoyer des secours aux familles de nos camarades nécessiteux, des ordonnances, surtout. Cette entre aide s'est poursuivie : après notre retour en France et dure encore pour deux ou trois cas. Elle a été le ciment de notre Association d'Anciens Prisonniers qui espère bien que cette formule durera tant qu'il y aura suffisamment de survivants pour la maintenir. J'ai parlé de l'organisation de la bibliothèque et de son fonctionnement. Mais, à coté de cette bibliothèque générale, se sont fondées quelques bibliothèques spécialisées - j'allais dire techniques -pour ceux de nos camarades qui ont pu ainsi poursuivre ou reprendre, au camp, des études interrompues… Les résultats obtenus ont été, clans la plupart des cas, reconnus et validés après notre retour. J'ai déjà cité le cas de François de Testa qui a pu entrer au Quai d'Orsay et je ne parle qu'en passant de la quinzaine de nos camarades, parfois des vocations tardives, qui ont profité du séminaire organisé par nos prêtres. Certains ont pu être ordonnés dès leur retour, comme Jean Peloux, qui était déjà diacre ; d'autres, plus jeunes ont commencé au camp leur formation comme Roger Aucagne ou Paul Haubtmann qui est entré chez les jésuites. A coté de ces cours et conférences, certaines manifestations de nos activités ont laissé nos gardiens quelque peu pantois : je veux parler des expositions. Nous nous étions groupés par affinité. Officiers, ingénieurs, coloniaux, etc… et au bout de quelques semaines, chacun de ces groupes a voulu présenter aux autres sa spécialité. On a donc préparé un certain nombre d'expositions. C'étaient, soit des expositions techniques : métallurgie, électricité, soit des expositions concernant les colonies françaises. J'ai ainsi participé à celle consacrée à l'Indochine, préparée par quelques officiers de la Coloniale, auxquels s'étaient joints ceux qui, comme moi, avaient des raisons particulières pour s'y intéresser. Les Allemands donnaient quelques facilités pour la préparation de ces expositions, et j'ai pu obtenir que Maman m'envoie quelques objets et quelques photos qui ont orné le stand du Cambodge que nous avons été deux ou trois à présenter. Une autre exposition a obtenu un grand succès : celle consacrée aux Missions. Les clous en étaient une grande fresque, due à notre camarade Lambert-Naudin, présentant les Saints de France, et qui, ensuite a servi de retable au fond du gymnase où se célébraient le dimanche la grande messe, et, surtout une remarquable maquette de Saint Pierre de Rome et de son esplanade, colonnes du Bernin comprises. Ma très modeste contribution à cette exposition, à part la fabrication de quelques unes des colonnes, pour lesquelles tous ont du travailler - a consisté à confectionner en carton une maquette élémentaire, en volume, de Notre-Dame de Paris et d'une de nos casernes pour donner l'échelle de l'ensemble. Je viens de relire la thèse que l'abbé Flament a consacré à notre Oflag, et je suis sidéré du nombre de choses, d'activités diverses tant intellectuelles que matérielles qui ont pu être faites dans ce camp : et je me rends compte que, sans le savoir, je suis passé à coté de richesses inouïes ! Bien sûr, j'ai un peu travaillé : j'avais demandé et reçu les études publiées par Léon Guillet, notre directeur et professeur de métallurgie à Centrale, sur la métallurgie et le travail de l'acier et des métaux légers. Chez Citroën, c'est une question qui m'avait intéressée et j'ai un peu travaillé sur ces livres. Mais, en fait, l'essentiel de mes journées - outre les déambulations à travers le camp et les répétitions théâtrales - s'est passé en d'interminables parties de belote avec des camarades de mon unité qui étaient encore dans la même chambre. C'étaient en particulier des instituteurs, des basques, Ladeveze et Errécart, avec qui je m'entendais très bien malgré les différences de nos conceptions philosophiques et religieuses, que nous admettions sans qu'il y ait eu le moindre frottement entre nous à ce sujet. Se joignait à nous, parfois, un autre tringlo de notre unité, agent de Renault à Bordeaux, Jacques Faure, qui occupait l'étage inférieur de mon châlit et que nous avions baptisé l'ectoplasme) car, à son réveil, le matin, nous le voyions vaquer à quelques occupations habituelles, manifestement pas encore lucide. Je m'étais fixé aussi une autre obligation. Au rez-de-chaussée de notre bloc, il y avait l’infirmerie, et en face, dans l'élargissement du couloir, chaque dimanche matin, l'aumônier du block, l'abbé Bruneau, disait sa messe, théoriquement à l'intention des malades, mais, pratiquement une bonne cinquantaine d’entre nous y assistait. Chaque dimanche, après avoir aidé Paul Haubtmann à monter l’autel, je servais la messe ; du moins lorsque je n'étais pas de service à la grand'messe du camp. Car l'équipe de séminaristes dont j'ai déjà parlé, avait constitué, avec la participation des routiers, un certain nombre d'équipes liturgiques de cinq ou six, qui, à tour de rôle, assuraient le service de la grand'messe. Autant que je me souvienne, dans celle dont je faisais partie, je remplissais, avec Lucien Reversat, les fonctions de céroféraire. Chaque équipe était de service toutes les six semaines environ, mais il y avait la grande équipe qui, elle, assurait les grandes fêtes, pour lesquelles la messe avait un caractère plus solennel. J'ai également pris part, de temps à autre, à un autre service, d'un tout autre genre. Assez rapidement à Arnswalde, étaient parvenus, camouflés dans des colis qui paraissaient anodins, mais qui faisaient l'objet de précautions très particulières lors de leur livraison, les éléments de deux ou trois postes de radio. L'abbé Flament, dans sa thèse, raconte toutes les précautions qui entouraient d'abord leur montage, puis leur utilisation. Celle-ci nécessitait, non seulement une écoute quasi permanente, mais aussi un guet, lui aussi permanent pour prévenir une fouille inopinée ou même simplement une visite inhabituelle d'un de nos gardiens C'était le rôle de quelques uns, très peu nombreux d'ailleurs et inconnus des autres, car il y fallait une très grande discrétion. Mais les nouvelles recueillies ainsi faisaient l'objet d'un bulletin quotidien qui était lu dans chaque chambre, évidemment aussi discrètement que possible. A mon étage, je me suis chargé quelques fois de cette lecture, ce fut ma seule - et on en conviendra, bien modeste - contribution à ce qui était la seule forme possible de résistance dans le camp ! J'ai dit que nos journées étaient ponctuées par des appels plus ou moins fréquents. Nous y étions convoqués par une sonnerie de clairon un quart d'heure avant, mais à des heures souvent très variées. Sur la place centrale, chaque block occupait le coté d'un carré ; nous nous y rendions, comme nous étions, sans souci de tenue, et, généralement, malgré les rappels à l'ordre de nos gardiens, le silence était des plus relatifs, chacun poursuivant les conversations commencées et il faut bien avouer que régnait une aimable pagaille ! Toutefois, en 1944, il y eut quelques appels mémorables. Avant même que nos gardiens n'en fussent avertis, la radio clandestine nous avait mis au courant des grands événements de la guerre. C'est ainsi que le débarquement en Provence et la libération de Paris ont été marqués par des appels exceptionnels. Ces jours-là, chacun essayait de revêtir une tenue aussi réglementaire que lui permettaient les quatre années de captivité passées et les dégâts qu'elles avaient produit dans notre vestiaire. Alors que, les autres jours, la pagaille qui présidait aux appels les prolongeait assez longtemps car elle était source d'erreurs chez les sentinelles chargées de nous compter, ces jours-là, la tenue irréprochable et le silence total désorientaient complètement nos gardiens qui expédiaient l'appel en quelques minutes et s'en retournaient, probablement en se posant des questions ! Et cette vie, qui devint de plus en plus étiolée après le débarquement et la disparition quasi totale des lettres et des colis qui assuraient : le lien avec nos familles et qui alimentaient nos popotes, s'est poursuivie jusqu'en janvier 1945. Vers le milieu de ce mois, l'avance des armées russes n'étant plus un mystère pour personne, des bruits ont commencé à courir sur une évacuation probable du camp. Nous doutant bien que ce départ se ferait dans des conditions difficiles, chacun a cherché alors comment il pourrait envisager ce départ en essayant de sauver ses biens les plus précieux, tout ce qu'il avait pu accumuler pendant quatre ans et demi - notes personnelles, objets d'artisanat, chefs d'œuvre patiemment confectionnés ,etc… en sachant très bien que notre état physique nous interdisait les colis trop pondéreux. On a étudié les meilleurs moyens de transport, depuis le traîneau fait de planches de lit assemblées et renforcées sur la tranche par des morceaux de fer blanc provenant de boites de conserve jusqu'aux musettes bricolées en passant par l'incontournable sac à dos. Tous pensaient que, par ces temps de grand froid et de neige, le traîneau serait le plus pratique, puisqu'il permettait le transport du maximum de bagages avec un minimum d'efforts. Les Allemands se sont même résolus à restituer quelques uns des bagages - en particulier des sacs - qu'ils avaient confisqués à notre arrivée. Enfin, nous avons appris que le départ était fixé au 29 janvier au petit jour. Toute la nuit fut occupée par les préparatifs de dernière heure : achèvement des bagages, répartitions entre les membres des popotes des quelques vivres qui nous restaient… et aussi cuisson à la schubinette de ceux d’entre eux qui étaient plus facilement transportables cuits que crus et enfin, au petit matin, ultime repas, aussi copieux que nous le permettaient nos très relatives richesses, en prévision d'une longue marche que la neige devait rendre encore plus pénible. Puis, nous nous sommes retrouvés dans la cour. Ce que nous ne pouvions pas emporter, a été rassemblé dans le grand hall-gymnase-église, avec sur chaque colis noms et adresses, car les Allemands s'étaient engagés - une telle promesse ne les gênait guère - à tout renvoyer en France. En fait, nous avons su, par la quarantaine de malades que nous avons dû laisser sur place, que, dès notre départ, ce dépôt a été pillé par la garnison allemande et même par les habitants de la ville. Dans la grande cour, pendant une attente qui n'en finissait pas, nous déambulions, par petits groupes chacun essayant de retrouver un ami pour lui faire ses adieux, car nous ne savions pas si nous resterions en groupes ou si nous serions répartis en plusieurs colonnes. D'ailleurs, certains, dès ce moment, étaient bien décidés à saisir la première occasion pour fausser compagnie à la colonne et à se camoufler en attendant l'arrivée des russes, au besoin même à aller au devant d'eux. C'est ainsi que j'ai trouvé François de Testa, fumant un énorme cigare, ce qui était un luxe inouï ; il l'avait reçu dans un de ses derniers colis et s'était promis de le fumer le jour de la Saint François (Saint-François de Salles) c'est-à-dire... le 29 janvier ! Enfin, vers 10 heures du matin, les portes du camp se sont ouvertes et nous avons commencé cet exode qui devait s'achever le 23 avril par notre libération par les Anglais, mais trois mois plus tard et à quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest. Cet exode a été raconté, presque au jour le jour, par notre camarade Rolland (alias Louis Francis) dans un livre publié quelques mois seulement après notre retour, « Jusqu'à Bergen ». Grâce à lui, j'ai pu reconstituer, à peu près, les étapes de ce retour, car, moi, je n'avais pas pris de notes ! La première étape s'est faite sous la neige. Cela facilitait grandement la progression des petits traîneaux improvisés (et ceux qui avaient choisi cette solution se réjouissaient), mais pour nous la marche était d'autant plus pénible que nous étions mal chaussés. Cette marche a commencé par la traversée de cette ville d'Arnswalde où nous venions de passer près de trois années sans la connaître et nous pouvions constater maintenant que bon nombre de ses habitants se préparaient, eux aussi, à la fuite, s'ils ne l'avaient déjà fait. Cela a rappelé à pas mal d'entre nous ce que nous avions vu sur les routes de France en mai 1940. Nous avancions en une colonne qui n'est pas restée longtemps très cohérente. Personne ne savait, les posten encore moins que nous, où nous dirigeaient nos pas. Petit à petit, sur le bord de la route, on voyait divers objets abandonnés par ceux qui avaient préjugé de leurs forces et se voyaient contraints, à mesure de l'avance, à se séparer d'une partie de leur chargement. Nous avions l'impression - et c'était probablement vrai - que rien n'était prévu pour notre halte, et ce n'est que vers minuit que nous avons trouvé refuge dans une église ou un temple qui allait nous servir d'abri pour la nuit. Rolland, comme d'ailleurs Lesort et Ikor dans leurs livres racontent qu'ils ont passé cette nuit sur les marches de la chaire ou blottis entre les bras du brancard des morts. Et, sur ce modèle, les étapes se sont succédées pendant plusieurs jours, sous la neige, couchant la nuit dans des granges, et avec pour tout ravitaillement ce qui nous avait été distribué au départ. Et puis, la neige a cessé de tomber et le dégel est arrivé, rendant inutilisables les petits traîneaux dont les propriétaires ont dû, à leur tour, abandonner une partie des trésors qu'ils avaient espéré pouvoir sauver. Le long de la route, il nous est arrivé de rencontrer des prisonniers français, polonais ou autres ; certains ont pu en obtenir quelques provisions ; en sacrifiant quelques cigarettes, voire une montre, en tous cas, ces contacts sympathiques et réconfortants nous donnaient les nouvelles dont nous étions privés depuis notre départ. Une nuit, on nous a arrêtés près de granges, à proximité d'un gros bourg, Sabow, de grandes granges où nous pensions pouvoir nous allonger et profiter d'un repos, dont nous commencions à avoir grand besoin. Mais, malgré leurs tailles ces granges qui, d'ailleurs étaient en partie occupées, n'ont pas suffi à nous accueillir tous. Les derniers arrivés ont été obligés de finir la nuit, étendus sur le sol, à la belle étoile. Certains prétendent y avoir entendu des tirs de canon et nous en arrivions à espérer être encerclés par l'avance de l'armée russe. Une autre nuit a été aussi mémorable ; elle avait commencé, fait exceptionnel, par une distribution de patates chaudes, mais elle a été particulièrement courte. Dès dix heures du soir, alors que nous commencions à nous endormir, il y a eu des cris de nos posten : « Tout le monde dehors avec les bagages, on repart ! » et c'est cette nuit-là que nous avons traversé l'Oder sur le pont de l'autoroute. La marche de nuit était rendue encore plus pénible par le verglas sur cet énorme pont exposé au plein vent et qui nous a paru interminable. Cette traversée, pour beaucoup, marquait la fin d'un rêve, celui d'être rattrapés et libérés par les Russes. Au cours des étapes, les popotes avaient été complètement bouleversées. Le groupe que nous formions maintenant, comprenait Paul Benoist, de mon ancienne popote, Paul Haubtmann, François de Testa et le Père Sochal. Nous nous soutenions les uns les autres au sens propre du terme, et je me rappelle avoir fait une partie des étapes au bras de l'abbé Sochal qui commençait à accuser une sérieuse fatigue. Après le passage de l'Oder, la marche s'est un peu ralentie, les étapes ont été plus courtes et même, certains jours, nous avons pu profiter d'arrêts pendant lesquels nous restions cantonnés dans une ferme. Il ne me reste de cette marche, que de très vagues souvenirs. C'était d'une telle monotonie qu'aucun fait saillant ne pouvait nous donner des points de repère exacts, d'autant plus que, comme je l'ai dit, et contrairement à notre camarade Rolland, je ne prenais aucune note et me laissais aller au jour le jour. Une de nos étapes nous a menés à Warren, gros village où nous avons eu l'agréable surprise de trouver un camion de colis de la Croix Rouge Américaine qui nous avait suivi à la trace. On peut imaginer la joie avec laquelle a été accueillie cette distribution : il y avait longtemps que nous ne mangions que de temps à autres, quelques soupes très légères à base de rutabagas, avec quelques pommes de terre, et ceci à des heures impossibles, après des arrivées tardives. A la fin de notre séjour à Warren (qui a duré deux ou trois jours), on nous a fait prendre le train. Nous étions à la fin de février : il y avait un mois que nous marchions par étapes plus ou moins longues, c'est dire si nous avons apprécié ce changement ! C'était un train de voyageurs. Nous étions assis sur des banquettes et certains mêmes, couchés dans les filets ou dans le couloir. Dans la nuit, nous avons franchi un grand pont et traversé ce qui restait de Hambourg : des pans de murs percés de trous qui avaient été des fenêtres, une ville fantôme, d'autant plus, bien sûr, qu'il n'y avait aucune lumière. Le lendemain, nous étions à Bremerworde, entre l'Elbe et la Weser. Nous avons repris la route à travers une plaine - qui paraissait sans fin - jusqu'au Stalag XB à Sandbostel, où nous sommes restés une huitaine de jours avant d'être emmenés, en camions cette fois, par la lande de Lünebourg, vers le camp de Witzendorf. C'était un camp, en lisière de forêt lui aussi, déjà occupé en partie par des officiers italiens arrêtés pour avoir refusé de poursuivre la guerre. On nous a évidemment installés dans une autre partie du camp et nous ne pouvions avoir de contacts avec eux que de part et d'autre des barbelés. Cette fois-ci, nous étions logés dans de très grandes baraques d'une trentaine de mètres, et nous y avons fait la connaissance d'un nouveau fléau qui nous avait été épargné jusqu'ici et qui est resté dans le souvenir de beaucoup le pire de tous, les puces. Je revois encore le corps de François de Testa qui en fut l'une des principales victimes et qui était littéralement couvert de piqûres. A Witzendorf où nous avions été précédés par quelques officiers venant d'un autre camp, j'ai eu la très grande joie de retrouver André Evette, un de mes anciens de Centrale, lui aussi du clan, et qui, à la sortie de l'Ecole était entré au Séminaire d'Issy. J'étais allé souvent l'y voir. Il avait été ordonné au début de la guerre et j'ai eu le plaisir de servir une de ses messes. Nous sommes restés trois semaines à Witzendorf, sentant autour de nous, de plus en plus, .les symptômes de la proche défaite allemande. Nous étions parfaitement oisifs, n'ayant rien à faire, puisque nous avions dû tout abandonner pendant notre voyage, nous n'avions plus rien. Pour seule distraction, les tirs d'une batterie de minenwerfen qui était venue se mettre en batterie non loin du camp ! Nous avons eu encore une distribution de colis américains. Nos aumôniers ont essayé de donner une certaine solennité aux cérémonies de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques. Le missel que j'avais gardé, un bon vieux Dom Lefebvre, porte encore les signes que j'y avais notés car j'avais tenu le rôle du récitant de l'évangile de la Passion. En fait, nous attendions la fin en nous demandant comment elle interviendrait et nous guettions les bruits lointains de la bataille. Le 12 avril, les Allemands qui nous gardaient ont disparu. Seul restait un vieux capitaine à qui était confié le camp avec l'assistance d'une douzaine de posten. Finis les appels interminables : on nous laissait le soin de nous garder nous-mêmes. Il a fallu s'organiser, et, la nuit suivante, c'est le commandant Beaurepaire qui a pris possession du poste de garde avec deux lieutenants et le vieux capitaine allemand. Pour le ravitaillement, des laissez-passer ont permis à une petite équipe d'aller chaque jour au village voisin réquisitionner ce qui nous était nécessaire. J'ai omis de dire qu'au cours de notre déplacement, la colonne avait été scindée et qu'une grande partie avait été dirigée vers I'Oflag VIA de Soest, où, d'ailleurs elle eut à subir une nuit de bombardement de la part des Américains, jusqu'à ce qu'ils aient pu signaler la présence, dans la caserne, de prisonniers français. Le 16 avril, un officier anglais s'est présenté à la porte du camp, accueilli, comme on le pense, par des clameurs et des cris de joie. En principe, nous dit-il, nous étions libres et il nous confiait la garde du camp, avec celle des quelques sentinelles allemandes et de l'officier qui avaient été désarmés et faits prisonniers à leur tour. Nous avons donc été quelques uns, parmi les plus jeunes à assurer à tour de rôle cette garde... qui ne sera pas de longue durée. Car, dès le lendemain, les Allemands reparaissaient sous la forme de deux compagnies venues récupérer nos prisonniers (qui pourtant pensaient bien la guerre terminée pour eux ) et qui repartaient en nous menaçant des pires représailles si nous sortions du camp, ces représailles pouvant même aller jusqu'au bombardement du camp ! Nous sommes donc seuls, isolés dans un espace qui paraît bien se situer maintenant entre les lignes allemandes et anglaises, et cela va durer trois jours ! Enfin, le 21 avril, nous apprenons que les allemands ont délégué auprès des Anglais, un de nos colonels afin de négocier une trêve de quelques heures qui permettra, le lendemain, l'évacuation du camp par une route qui sera neutralisée le temps nécessaire à cette évacuation. Et le dimanche 22 avril, nous reprenons la route, mais cette fois, à la queue leu leu, sur son côté. A un moment, nous dépassons une mitrailleuse dans sa gaine de protection sur le coté de la route, mais ses servants ne se montrent pas : c'était la dernière mitrailleuse allemande. Un peu plus loin, un officier anglais nous accueille dans un français teinté d'un fort accent : « Bonjour, Messieurs, voici la route de la liberté ! » Nos très légers bagages sont chargés dans quelques camions qui nous attendaient et c'est, très légers, les mains dans les poches, que nous nous dirigeons vers la ville toute proche de Bergen. Un peu surpris, tout de même de croiser quelques allemands encombrés de bagages et d'entrer dans une ville entièrement vidée de sa population. Nous en aurons bientôt l'explication. Le matin même, les Anglais ont donné aux habitants un ordre d'évacuation totale avant quatorze heures et nous sommes invités à occuper les maisons ainsi libérées, entièrement mises à notre disposition. C'est un peu plus tard que nous connaîtrons la raison de ces mesures. Nous ignorions totalement l'existence des camps d'extermination ; et ce n'est que petit à petit que nous avons appris ce qu'ils étaient et l'existence à proximité immédiate de Bergen, de l'un d'eux, celui de Belsen. Les Anglais, persuadés que les habitants de Bergen ne pouvaient l'ignorer avaient pris cette première mesure de représailles. Nous nous sommes donc installés très confortablement. Notre groupe s'est vu attribuer un petit hôtel d'une dizaine de chambres et qui était bien pourvu de victuailles diverses. Je ne dirai pas le plaisir de retrouver un vrai lit, avec des vrais draps ! Je partageai ma chambre avec Paul Benoist à coté de qui j'avais vécu toute la captivité y compris la marche finale. Le soir même un Te Deum était chanté par nos aumôniers dans l'église ou le temple de la ville. Nous sommes restés à Bergen une huitaine de jours en attendant un rapatriement qu'il fallait organiser et qui s'est échelonné, au fur et à mesure qu'étaient disponibles des moyens de transport qui pouvaient aussi bien être un avion ou un camion. Nous avons reçu la visite des anciens propriétaires des maisons que nous occupions, venus tenter de récupérer quelques objets oubliés. Evidemment, aucun n'avait été nazi et tous ignoraient l'existence du camp de Belsen. Et pourtant la fouille des maisons nous a apporté des preuves, tel la baïonnette d'Hitlerjungend que j'ai toujours conservée. Très vite, nous avons vu arriver d'autres anciens prisonniers, des russes en particulier, en quête de vols et de rapines, au point même que nous avons dû garder, en armes, les quelques artisans (boulanger, boucher…) que les Anglais avaient réquisitionnés pour assurer notre ravitaillement. C'est aussi à ce moment que nous avons eu la révélation du camp de Belsen. On nous avait recommandé de ne pas diriger nos promenades de ce coté, mais sans nous donner d'explications. Bien entendu, quelques uns y sont tout de même allé voir, et, un soir, ils nous ont ramené de là-bas, méconnaissable dans son pyjama rayé, un de nos camarades de Gross-Born. Lorsque les Allemands avaient fait du racolage parmi nous en nous offrant du travail chez eux, - ce qui était considéré comme une désertion - Jean Babin - avait accepté, ce qui nous avait beaucoup peiné. Mais, en fait, travailleur libre à Stettin, il avait organisé un réseau d'évasions de prisonniers vers la Suède. Pris, il avait été déporté à Belsen, où il était arrivé à survivre jusqu'à la libération, et où nous l'avons retrouvé d'une maigreur à faire peur ! Nous lui avons proposé de lui trouver une tenue et de le ramener avec nous dans notre rapatriement prochain. Très sagement, il a refusé : on craignait le typhus à Belsen, aussi préférait-il se soumettre aux examens et aux désintoxications prévues. Je ne l'ai jamais revu et je ne sais même pas s'il est rentré en France et a survécu. Les premiers d'entre nous à rentrer, choisis par tirage au sort, sont partis par avion pour Le Bourget ; les avions de transport qui amenaient aux troupes en action matériel et ravitaillement, repartaient à vide et, tant que le front était encore assez proche de notre cantonnement provisoire on les remplissait au retour, de prisonniers rapatriés. Cela n'a pas duré longtemps, tant l'avance des troupes alliées était rapide, et, très vite, l'acheminement s'est fait par camions jusqu'aux régions où les voies ferrées avaient pu être remises en service. Nous avons franchi le Rhin sur un pont de bateaux et nous nous sommes arrêtés quelques heures dans une bourgade allemande qui avait bénéficié d'apparitions de la Vierge et dont la population s'est montrée très surprise que nous ne la connaissions pas alors qu'eux connaissaient bien Lourdes ! C'est là que nous avons trouvé un train qui nous a amené à Lille par Maastricht et Bruxelles. Mais je ne peux pas fermer cette longue histoire de la captivité sans évoquer tous les amis que je m'y suis fait. On ne partage pas, pendant cinq années les mêmes tribulations, les mêmes peines, les mêmes espoirs, sans que ne se tissent des liens qui , malgré les séparations ultérieures, restent forcément très forts et qui, souvent ne sont rompus que par la mort... Et c'est le cas de presque tous ceux que je vais citer maintenant. Et tout d'abord - à tout seigneur, tout honneur -, Monseigneur, I'abbé André Sochal, que tous, au camp, appelaient ainsi Monseigneur. Il fut, d'ailleurs vicaire général du diocèse d'Angoulême, après son retour. Ses activités étaient multiples : aumônier du block II, conférencier, professeur au séminaire, et, surtout, il fut le grand metteur en scène du camp et celui à qui tous venaient demander conseil en cas de difficultés. Je ne peux pas citer toutes les pièces qu'il a montées ou aidé à monter, d'abord pour son block II, et, ensuite, à Arnswalde, pour l'ensemble du camp. Mais il faut parler des quatre ou cinq qui nous ont le plus marqué. Dès le premier hiver, et avec des moyens de fortune, il faisait jouer le « Noël sur la place », de Herri Ghéon ; un peu plus tard, « Noé », d'Obey, avant cette « Annonce faite à Marie » de Claudel, où nous avons été très émus par le jeu de Jean Peloux (Violaine) et, surtout, par celui de Jacques Debia (Mara). Il ya eu aussi le « Fleuve Etincelant », de Morgan, dont la traduction française n'avait pas encore paru et que Sochal a fait traduire par quelques camarades, dont Paul-André Lesort. Pour les Routiers du camp, il a mis en scène la « Compassion de Notre Dame » que nous avons joué dans la grande halle d'Arnswalde, à l'occasion de Pâques, en 1944. Pour toutes ses pièces, Sochal s'était adjoint, comme régisseur et accessoiriste, Lucien Reversat... et c'est de là qu'est née notre amitié. J'ai revu le Père Sochal plusieurs fois à Paris où il ne manquait jamais nos réunions annuelles. En 1947, je lui avais demandé de venir bénir notre mariage. Le matin même, j'ai reçu un télégramme dans lequel, il s'excusait de ne pouvoir venir ! Heureusement, j'avais prévu une solution de rechange. Sochal est mort, il y a quelques années, presque aveugle, et son enterrement, auquel je n'ai pas pu assister, à Angoulême, a été tout de même pour moi l'occasion de renouer, après des années, avec Jacques Faure que je n'avais pas revu depuis 1945. La défection du Père Sochal à notre mariage n'a pas été une catastrophe car, dès le début, j'avais espéré que serait aussi présent Jean Peloux, qui, lui, est venu. Jean était séminariste du diocèse de Lyon et il avait été ordonné diacre au début de la guerre. Il était un de nos deux diacres ; l'autre, également du diocèse de Lyon, Pierre Prenat, était plus âgé que nous ; c'était une vocation tardive. Jean avait animé le séminaire du camp et il suivait les activités du clan routier. Dès son retour, il a été ordonné. Par la suite, il a été vicaire épiscopal de l'évêque de Roanne. De Cleyriat, nous sommes allés une fois passer une journée avec lui. Lui aussi, était assidu à nos réunions annuelles et nous nous y retrouvions toujours avec joie. Puisque j'en suis à parler de nos séminaristes, il faut faire une mention toute spéciale d'Emile Laxague - Milou - , un basque, champion de pelote. Il était de Saint Etienne de Baigorry. En I946, lorsque j'ai emmené mon clan de Sainte Jeanne de Chantal camper en pays basque, l'une des étapes a été précisément, Saint Etienne de Baigorry et, dans la soirée, Milou - puisque c'est ainsi que nous l'appelions - est venu animer notre veillée et nous parler de son pays. Je l'ai revu une autre fois à Bayonne où il était professeur au séminaire. De passage dans la région, pour le compte de ma société, j'avais rencontré dans le train notre ami Alain Beauvais, et nous avions décidé d'aller faire visite à Milou. Il a été le héros d'une affaire qui a défrayé la chronique après la guerre, l'affaire Finaly. C'étaient deux enfants juifs dont les parents avaient été déportés et avaient disparu en Allemagne. Les enfants avaient été adoptés par une famille chrétienne qui les avait fait baptiser. Lorsque leur famille juive les a réclamés, Milou, qui s'en était fait le défenseur, a refusé de les présenter et les a fait émigrer provisoirement en Espagne. Condamné, il a fait quelques mois de prison et je ne sais pas quel a été l'épilogue de cette affaire. Par la suite, iI a été curé de Saint Jean de Luz, puis aumônier d'une maison de retraite. Il est mort d'une crise cardiaque, sur le bord de la route où il attendait le car qui devait l'emmener pour un pèlerinage en Terre Sainte. J'ai déjà parlé du benjamin des « Foutriquets », Paul Haubtmann. Je pense que c'est avec lui que je me suis le mieux entendu, et si je devais dire quel a été mon meilleur ami, c'est sûrement son nom qui me viendrait à l'esprit. Paul était le plus jeune enfant d'une très nombreuse famille stéphanoise. Déjà deux de ses frères étaient prêtres - dont l'un sera recteur de l'Institut Catholique de Paris - Deux ou trois de ses sœurs étaient religieuses, Enfin, deux autres frères étaient mariés, mais l'un s'est tué en montagne et il n'en restait qu'un pour diriger l'imprimerie familiale à Saint Etienne. Il venait de sortir de Stan ; ayant été reçu à je ne sais quelle grande Ecole, mais sans pouvoir y entrer puisqu'il avait été mobilisé tout de suite, et, de toute façon, il était bien décidé à entrer chez les jésuites dès qu'il le pourrait. Il a été l'élément spirituel de la popote dont il fut le « Chapelain » : c'est le surnom qui lui est, d'ailleurs, resté, même en dehors de notre groupe. A Arnswalde, il a quitté notre groupe ; tout en suivant les cours du séminaire, il s'était fait le popotier des aumôniers du block III, les abbés Bruneau et Villacroux. Après sa libération, il est entré à la Compagnie de Jésus. Nous sommes allés le voir, quand il était au séminaire de Villefranche. J'ai pu assister à son ordination à Lyon, et à sa première messe à Saint Etienne. C'était en 1952 et c'est à lui que nous avons demandé de baptiser Bruno. C'était son premier baptême et je l'ai souvent taquiné par la suite en prétendant qu'il avait dû oublier quelque exorcisme, ce dont il s'est toujours défendu. Pendant quelques temps, nous ne l'avons revu que lors de ses rares passages à Paris, il était, avec son frère Georges, aumônier des étudiants à Grenoble Puis il est venu à Paris, rue de Sèvres, chargé par la Compagnie, de l'apostolat des non croyants. Il est venu quelquefois nous voir à Versailles et je me souviens surtout de notre dernière rencontre. C'était un mardi saint et il m'avait invité à déjeuner rue de Sèvres, à la « Jésuitière ». Avant le déjeuner, à midi, tous les prêtres présents se rassemblaient et concélébraient la messe. J'étais le seul laïc : on m'a fait place dans le cercle des sept ou huit prêtres, autour de l'autel. Après le déjeuner, il m'a emmené dans sa chambre et nous avons longuement parlé de nos souvenirs communs et de son nouvel apostolat. Je ne I'ai jamais revu ; peu de temps après, j'ai appris qu'il était gravement malade; on l'avait transporté dans une maison de santé à Annecy. Un jour, de passage chez mon beau-frère Gilles qui était en garnison à Annecy, j'ai essayé d'aller le voir ; je n'ai pas été reçu, son état de santé interdisant toute visite, car il était très diminué et avait même perdu l'usage de la parole. Il est mort peu après d'un cancer du cerveau. Paul Haubtmann avait au camp un grand ami qui partageait avec lui la gestion de la popote des aumôniers : François de Testa ; aussi avons-nous très vite sympathisé. François était un des plus jeunes officiers du camp, et, grâce aux cours des professeurs et des quelques diplomates qui partageaient notre captivité - je pense en particulier à François Leduc qui, par la suite fut entre autres postes, l'ambassadeur de France au Canada qui reçut de Gaulle lors de sa fameuse visite - il a pu préparer le concours d'admission aux Affaires Etrangères. C'est en sa compagnie que j'ai fait la dernière partie de notre voyage de retour, que j'ai partagé le premier repas au wagon-restaurant ; et que nous avons ainsi découvert combien avait changé la valeur des choses pendant notre absence. II a été successivement consul de France à Alexandrie, puis à Istanbul, attaché d'ambassade au Pakistan - c'est là qu'il a rencontré sa femme, fille de l'attaché militaire - et enfin ambassadeur au Népal. Lui aussi, est mort, il y a quelques années d'un cancer de la vessie. Un autre groupe, dont il faut que je parle, est celui des anciens de mon unité, ceux avec qui j'ai été fait prisonnier, et avec qui j'ai vécu les premières semaines de cette captivité. Au début, nous étions tous dans la même chambre, mais trop nombreux pour ne former qu'une seule popote, petit à petit, nous nous sommes dispersés, tout en restant, jusqu'au bout le noyau de la III- 314 à Arnswalde. Le groupe a donc beaucoup évolué : les anciens combattants sont partis, d'autres, tel Dumont ont pris un service permanent - Dumont était logé à la poste - . Mais il en est un que j'ai toujours suivi, avec qui nous partagions le même châlit, à un étage de distance, aussi bien à Gross-Born qu'à Arnswalde et qui a été d'un bout à l'autre de la même popote: Jacques Faure. Plus âgé que moi de quelques années, il était représentant de Renault à Bordeaux, ce qui l'avait fait désigner comme officier mécanicien de notre groupe de transport. Il était protestant et très attaché au groupe des « parpaillots », à la paroisse protestante qui s'était constituée au camp. Nous étions restés très liés et, après notre retour, lorsque je suis passé par Bordeaux, je lui ai fait signe, et aussitôt, il a organisé un dîner chez lui avec quelques anciens de la compagnie, notre capitaine, Piveteau qui avait été rapatrié comme ancien combattant et Pierre Dumont, négociant en vins, quai des Chartrons. Puis, pendant de longues années, nous n'avons plus eu l'occasion de nous rencontrer, lui à Bordeaux et moi à Paris. Et c'est à l'enterrement du Père Sochal qu'il s'est trouvé à coté de François de Testa et qu'il lui a demandé des nouvelles de quelques camarades, dont Paul Haubtmann et moi. Il m'a tout de suite téléphoné et, comme nous devions aller à Bordeaux quelques temps après, nous nous sommes retrouvés, cinquante ans, après comme si nous nous étions quittés la veille. Il insistait toujours pour que nous retournions le voir, mais il vient de mourir l'année dernière. Un autre membre de notre groupe m'avait pris en amitié, le capitaine Alain Beauvais : c'était un vieux garçon très sympathique, très artiste et excellent pianiste ; il a donné plusieurs concerts au camp. J'ai déjà raconté notre rencontre dans le train de Bayonne et notre visite à Milou au séminaire. A Arnswalde, il faisait popote avec un autre officier de notre groupe, Robert Lapresle. Il est diflïcile d'imaginer couple plus disparate : autant Beauvais était raffiné et même un tantinet précieux, - nous l'appelions « Tante Aglaé » - autant Lapresle était brut de fonderie, exagérant même intentionnellement son caractère grossier et ses expressions souvent ordurières. Au demeurant, le plus brave garçon qui soit et qui couvait le fluet Beauvais comme l'aurait fait une mère poule. Il était rochefortais, chef des services techniques de la ville. C'est lui qui, revenu quelques jours avant moi, avait prévenu Maman de mon très prochain retour. Il s'était marié au début de la guerre, profitant d'une disposition particulière qui permettait aux mobilisés de régulariser leur situation, sans avoir à respecter le délai de la publication des bans, avant de partir. Mais, à son retour de captivité, il n'avait pas retrouvé sa femme, partie avec un autre et qui avait demandé le divorce, lequel avait été prononcé même avant ce retour. J'ai passé à Rochefort quelques mois avant de revenir à Paris en 1945. Pendant cette période, j'ai vu souvent Robert Lapresle et, un jour, j'ai assisté à sa rencontre avec une jeune employée de la Trésorerie. Deux mois après, il se mariait et me demandait d'être son témoin. Le mariage s'est fait dans un village des environs de Périgueux où les parents de la mariée étaient cultivateurs. Il est mort il y a quelques années et, à chacun de nos passages à Rochefort, nous ne manquons pas d'aller faire une visite à sa femme. Au cours des trois mois que j'ai passés à Rochefort, après ma libération, j'ai reçu pendant quelques jours la visite d'un autre « foutriquet », Paul Benoist. C'était le beau-frère de Gilles Renaud, un ancien du clan de Centrale. Bien qu'ayant fait lui-même H.E.C., Paul s'était incorporé au « Mégaclan », c'est-à-dire aux anciens du clan, et je l'avais retrouvé dès le début de la captivité que nous avons vécue ensemble, dans la même popote, jusqu'au bout. C'était un garçon très curieux à qui la captivité a posé de très nombreux problèmes, en particulier dans le domaine de la foi. Il était très généreux, cherchant ce qu'il pouvait faire, comment se rendre utile ; à Arnswalde, il avait accepté de s'occuper de l’atelier où un certain nombre de nos ordonnances étaient regroupés pour y exercer divers travaux: les tailleurs, les coiffeurs, les cuisiniers... Cela ne devait pas être facile : certains hommes voyaient d'un mauvais œil la présence d'un officier à la tête de cet atelier. A la libération, quelques uns de ces hommes ont eu des mots très durs pour celui qu'ils considéraient un peu comme un espion ! Paul est donc venu passer trois ou quatre jours à Rochefort. Plus tard, il s'est marié ; il a habité La Celle Saint Cloud où nous l'avons vu, puis il est parti à Rouen. Jamais, il n'est venu à nos réunions annuelles .Je ne l'ai donc plus revu et il est mort à Rouen, il y a quelques années. J'ai dit, plus haut, que pour l'aider dans la régie des spectacles qu'il montait, le Père Sochal avait choisi un des routiers de son block, Lucien Reversat. Lorsque, après notre arrivée à Arnswalde, il n'y eut plus de séparation entre les blocks, les troupes théâtrales, sans fusionner totalement, se sont souvent mêlées. Chaque metteur en scène pouvait choisir les « vedettes » qu'il souhaitait pour chacun des rôles, sans se limiter à celles de son block. C'est ainsi que, à Pâques 1943, Sochal a accepté de monter pour le clan, la « Compassion de Notre-Dame », du répertoire des Comédiens Routiers. Jean Peloux était la Vierge Marie, Maurice de Jacquelot le récitant, Michel Iweins le Christ et je tenais le rôle de Saint Pierre. Lucien Reversat assurait la régie et de là date notre amitié. Plus tard, Lucien a rejoint notre popote pour nos derniers jours de captivité. Officier d'active, il était marié avec une alsacienne, Cécile, et nos deux ménages se sont souvent rencontrés, après la guerre, lorsque les Reversat n'étaient pas en Indochine, où ils ont fait un séjour pendant lequel est né Jean-François dont Lucien devait être le parrain. Ils ont été un moment en garnison à Versailles, car il avait été versé dans le Génie. Après son départ de l'armée, il est entré dans une société parisienne chargée de la vérification et de la conformité aux règles des bâtiments : son passage par le Génie l'y avait préparé. Ils se sont installés à Marly-Grandes-Terres où ils ont acheté un appartement. Ne pouvant avoir d'enfants, ils ont adopté des jumeaux. Mais Cécile est morte d'une crise cardiaque, alors que les jumeaux n'avaient qu'une dizaine d'années et Lucien s'est remarié avec une cousine, Jeannine. Ils habitent toujours à Marly. Chaque année, ils allaient passer leurs vacances sur les bords du lac d'Annecy et ne manquaient pas de faire étape à Cleyriat. Lucien est mort l'année dernière. C'est aussi au théâtre que je dois quelques amitiés dont je parlerai un peu plus lorsque j'évoquerai les spectacles auxquels j'ai participé. Mais il en est deux qui m'ont plus frappé parce que ce sont des amis que j'ai eu l'occasion de revoir assez souvent. L'un est Pierre Brienne qui avait été mon partenaire dans la pièce de Jules Romains, « Monsieur Le Trouhadec saisi par la débauche ». Nous y partagions les rôles de jeunes premiers, lui assurant celui de la jeune femme que son physique lui permettait alors de remplir sans ridicule aucun. Ancien élève des Arts et Métiers, il s'était passionné pour le métier militaire et il était resté dans l'armée quelques temps, ce qui lui a permis d'atteindre le grade de colonel, ce dont il était très fier. Marié avant la guerre, il avait dû divorcer à son retour, et a épousé Marie-Hélène Joly, de beaucoup sa cadette ; il a eu deux enfants et m'a demandé d'être le parrain de l'aîné Frédéric. Nous voyions souvent ce ménage, soit que nous nous rencontrions dans la région parisienne, soit à la campagne, en Lozère où ils ont acheté une vieille ferme, complètement isolée, au milieu des châtaigniers, à quelques kilomètres des villages les plus proches, Saint Germain-de-Calberte ou Saint Etienne-Vallée Française… Pierre Brienne, aussi, est mort l'an dernier. Un autre camarade avait partagé avec moi les rôles du « Médecin malgré lui » : André Delorme que, après des années, j'ai retrouvé à Versailles. Lui aussi était officier d'active, de cavalerie, sorti de Saint Cyr juste au moment de la guerre. Il a terminé sa carrière militaire comme colonel, attaché militaire à Washington. Après sa retraite, installé à Viroflay, il y a eu une pénible aventure : un jour réveillé brusquement pendant sa sieste, il a constaté la présence d'un cambrioleur ; saisissant un revolver dans un tiroir, il a tiré et tué son visiteur. Acquitté, bien sûr, il a tout de même quitté Viroflay pour Chartres d'abord, puis pour Versailles où j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. J'ai parlé de la création, au camp, du « Centre d'Entraide », qui a été à l'origine, après notre retour, de notre Association d'anciens prisonniers de l'Oflag IID-IIB. J'ai dit qu'il avait été créé à l'initiative de trois ou quatre d'entre nous, dont Jean Glotin, président de « Marie Brizard », et qui avait engagé sa société dans la redistribution en France, pendant même notre captivité, de secours aux familles de prisonniers nécessiteux, au moyen d'un système de péréquations qu'il serait trop difficile d'expliquer ici. Il a été aussi pour moi un grand ami. Il m'avait associé quelquefois au travail matériel de classement et de rangement des « marchandises » gérées par le Centre. Nous nous étions trouvés des goûts communs et, comme il était aussi au block III à mon étage, je ne compte pas les soirées que nous avons passées, après la fermeture des portes, à arpenter le couloir de l'étage en devisant sans fin. Pendant les quelques semaines que j'ai passées à Rochefort à mon retour, j'ai eu la joie de le rencontrer un jour ; il faisait du bateau, et, ce jour-là, il faisait escale au port. Je l'ai amené à la maison où Alphonsine nous a fait un café comme nous n'en avions pas au camp ! Il est resté de longues années président de notre Association et nous nous revoyions tous les ans à notre assemblée. Plusieurs fois, aussi, nos chemins se sont croisés à Paris, boulevard Haussmann, lorsque je me rendais à mon bureau et lui à la Chambre Syndicale des Vins et Spiritueux qu'il présidait. J'ai eu beaucoup d'autre amis au camp, mais qui m'ont moins marqué que ceux-là, nos relations étant probablement plus du domaine de la camaraderie que de l'amitié, et nous nous sommes perdus de vue sauf à nous rencontrer à nos réunions annuelles. J'en cite tout de même trois ou quatre : Henri Loup, un de mes anciens ; pendant quelques temps, avec Lucien Reversat nous nous retrouvions, à Paris pour déjeuner ensemble. Il avait un fils maître verrier et nous avons été conviés un jour au vernissage d'une de ses expositions. Pierre Birckel, un jeune polytechnicien en compagnie de qui j'ai fait bon nombre de tours de camp. A son retour, officier d'active, il s'est spécialisé dans l'arme atomique ; devenu colonel, il a péri dans le crash d'un avion qui emmenait vers le plateau d'Albion, une dizaine d'officiers généraux et supérieurs pour une inspection. Roger Aucagne, un autre séminariste du diocèse de Lyon ; j'ai assisté à son ordination à la primatiale Saint Jean où j'ai retrouvé Sochal, Peloux et bien d'autres. Dans les dernières années, il était le Supérieur du collège où enseignait à Roanne, l'abbé Neyron, I'oncle de Geneviève. Paul-André Lesort, Versaillais, que je rencontrais de temps à autres. Nos enfants étaient ensemble à Hoche. Ayant abandonné la banque pour la littérature, et lecteur au Seuil, il a publié plusieurs romans dont deux au moins ont en partie pour cadre notre camp, les autres laissant deviner à quel point il a été marqué par cette captivité. J'arrête là cette liste qui pourrait encore s'allonger. La plupart sont morts maintenant. Des survivants, quelques uns, de moins en moins nombreux, se retrouvent chaque année, au mois de mars, à la journée de I'Oflag. Elle commence par une messe qui, longtemps a été concélébrée par sept ou huit de nos aumôniers, mais le dernier survivant de nos aumôniers, l'abbé Villacroux, vient de mourir à son tour. L'assemblée générale commence par l'appel des morts de l'année. Elle se poursuit par l'exposition des derniers cas d'entraide. Car notre association a fidèlement conservé ce rôle qui a été à sa création et continue à l'exercer. Après la mort de François de Testa qui était membre du Conseil d'administration, le président, Jean Simon, m'a demandé d'en devenir membre, ce que je suis toujours. Retour de captivité Il faut tout de même que j'évoque, même très succinctement les quelques mois qui ont suivi notre retour en France, cette période de grandes joies, mais aussi de grandes déceptions. Depuis cinq ans, nous étions pratiquement coupés de la France. Ce ne sont pas les très rares lettres, très raccourcies, qui étaient autorisées, ni les journaux soigneusement triés que nous pouvions recevoir, qui pouvaient nous renseigner sur ce qui se passait en France. Seule la radio clandestine nous donnait-elle un aperçu de la situation de notre pays Et, de plus, depuis le débarquement en Normandie, c'est à dire depuis dix mois, ces quelques sources d'informations ne nous parvenaient même plus I C'est dire que nous n'étions absolument pas préparés à ce qui nous attendait à notre retour. J'ai raconté comment, après un voyage en camion, puis en train, par Maastricht et Bruxelles, nous nous étions retrouvés à Lille où se sont déroulées les premières formalités du rapatriement. Nous avions, au camp, un très bon camarade, Jean Ratinaud, charentais, professeur d'histoire au Lycée de La Rochelle dans le civil, et l'un de nos meilleurs conférenciers dont nous suivions toujours avec plaisir les exposés. Après notre retour, il a publié quelques nouvelles dans lesquelles il raconte quelques anecdotes sur sa captivité. Et, dans la dernière, « La saison du mensonge », il raconte cette première formalité. Je lui laisse la parole : « Le premier contact que Liotaud et Travers eurent avec leurs compatriotes prit la forme d'une conversation avec une fille outrageusement fardée et maquillée. Ses paupières dégouttaient d'un rimmel noir et gras. Ses énormes fesses tendaient un pantalon kaki, ses seins flasques étaient sanglés dans un blouson de l'armée. Elle était coiffée d'un calot dont s'échappaient des cheveux oxygénés. Ses ongles étaient couverts d'une laque rouge vif qui s'écaillait par plaques. Elle portait des galons de sergent !- Alors, dit la femme-soldat, les naphtalinés, vous voilà sortis d'affaires, - Vaut mieux sentir la naphtaline que la putain, répondit Liotaud qui n'avait pas perdu sa langue en voyage. - Causez correctement, reprit la femme indignée, en voilà des vaches ! - Vaut mieux être vache que morue, réitéra Liotaud. - Oh ! Et puis je vous em… et, se retournant, la fille tendit vers les deux hommes, en un geste obscène, la rotondité de ses fesses. Ce fut le salut de bienvenue de la patrie à ses enfants involontairement prodigues ». Ce récit est évidemment un peu romancé : si, maintenant, en France, un sergent pouvait s'adresser ainsi à des officiers, qu'allions nous trouver ? Mais il est tout de même un reflet assez fidèle de la réception qui nous attendait ! Nous avons subi alors un interrogatoire serré par quelques officiers français qui voulaient absolument savoir si, dans notre camp, il avait existé un cercle Pétain et qui en étaient les responsables. Nous avons refusé de répondre à ce genre de questions, et nous avons senti tout de suite qu'en France, l'atmosphère était à la délation ; nous ne voulions pas entrer dans ce jeu-là : ce n'était pas ce que nous espérions de notre retour ! A l'issue de ces formalités, on a remis à chacun de nous un billet de mille francs pour les frais que nous pouvions avoir au cours du voyage qui allait nous ramener chez nous. Mais nous ignorions complètement quelle était maintenant la valeur de l'argent. Le soir même, on nous embarquait dans un train pour Paris. Ce train mit je ne sais combien d'heures pour rejoindre la gare du Nord par un itinéraire compliqué que je serais bien incapable de reconstituer. J'étais avec François de Testa et nous avons décidé d'aller prendre au wagon-restaurant notre premier dîner d'hommes libres. Je revois encore notre tête, lorsque nous est arrivée l'addition : notre malheureux billet de mille francs a été très écorné, car, si j'ai bonne mémoire, cette addition devait approcher les six cent cinquante francs ! J'ai passé une journée à Paris. Je suis allé à Boulogne voir les Stoeckel. Et, le soir, j'ai pris le train pour Saintes où j'ai débarqué le lendemain matin, après un nouveau voyage de nuit. Le train n'allait pas plus loin, car les poches allemandes de La Rochelle et de Royan venaient à peine d'être libérées. Cette journée du dimanche 13 mai à été occupée par les formalités de ma démobilisation. On m'a établi une belle carte provisoire d'ancien prisonnier de guerre; on m'a pourvu de tickets d'alimentation ; et j'ai attendu jusqu'au soir un car qui allait m'amener à Rochefort. Le chauffeur, gentiment, a fait un petit détour pour me déposer rue de la République, juste devant la maison. Maman m'y attendait, prévenue quelques jours plus tôt par Robert L……. qui avait bénéficié d'un retour un peu plus rapide que le mien, J'avais décidé de ne retourner à Paris et de ne reprendre ma place chez Citroën qu'après le 15 août. D'ici là je voulais me refaire un peu à Rochefort où Maman m'a dorloté, où j'ai retrouvé mon ami L……. que sa femme avait abandonné pendant son absence en demandant le divorce. Mais, bientôt, il a fait la connaissance d'une jeune fille qui était employée à la Trésorerie et ils se sont mariés dans les premiers jours d'août dans les environs de Périgueux où les parents de la mariée étaient agriculteurs. J'avais accepté d'être le témoin de Robert L…….. et je suis donc allé passer quelques jours dans le village, dont je ne me souviens pas le nom, où avait lieu la noce. Un jour, Maman m'a emmené à Royan, pour constater les dégâts ; du bombardement. Je connaissais bien Royan où j'avais passé mes vacances pendant une quinzaine d'années ; et pourtant je m'y suis perdu ! C'était la première fois que je circulais dans une ville récemment bombardée, mais qui avait déjà été nettoyée. Seuls restaient debout le monument aux morts, près de la maison, et le bâtiment de la poste. Tout le reste du centre de la ville n'était plus qu'un désert où l'on ne retrouvait que la trace des anciennes rues. Nous n'avons retrouvé de la maison que quelques murs ; elle s'était écroulée; et, de plus, elle avait été pillée: dans la salle à manger, le buffet était appuyé contre un mur porteur qui l'avait protégé. I1 était intact...mais vide ; toute la vaisselle et l'argenterie avaient été enlevés. Avant ou après le bombardement ? Nous ne le saurons jamais, et c'est d'ailleurs sans importance ! J'ai fait aussi un voyage d'une quinzaine de jours dans le midi. Suzette, qui avait eu un fils, Stéphane, en 1942, s'était plus ou moins bien remise après l'accouchement, et elle devait aller faire une cure à Vernet-les-Bains, où notre cousin, Jacques Olivier était médecin et devait la suivre. Je l'y ai donc accompagné et y ai passé quelques jours, ce qui m'a permis de faire l'excursion du Canigou. De là je suis parti pour Hyères où habitaient alors les Négrié, car Joseph était à l'hôpital maritime de Toulon. Ce fut un séjour très agréable : il n'y avait pratiquement que nous sur les plages ; Jacqueline Stoeckel est venue aussi à ce moment-là passer quelques jours de vacances. Et puis, il a fallu songer au retour. Le premier problème qu'il me fallait résoudre était celui du logement. Pendant ces années, les Editions du Seuil s'étaient beaucoup développées et les locaux de la rue des Poitevins ne leur suffisant plus, elles avaient déménagé et étaient allés s'installer rue Jacob, où elles sont toujours, d'ailleurs. On avait vidé l'appartement de la rue des Poitevins et Renée s'était chargée de prendre les meubles et les affaires que j'y avais laissés pour les entreposer à Boulogne. Il me fallait donc trouver un nouveau logement. Heureusement, les Stoeckel avaient fait la connaissance d'une famille anglaise, les Wells (e crois que Jacqueline avait donné des leçons à leur fille Hélène) qui, la guerre terminée voulaient retourner en Angleterre. Ils m'ont laissé leur appartement, au 101 rue Erlanger et je leur ai racheté les meubles et les quelques installations qu'ils abandonnaient. Et, après le 15 août, j'ai retrouvé ma place chez Citroën.... Quand je dis que j'ai retrouvé ma place, ce n'est pas tout à fait vrai. L'industrie française avait été durement touchée pendant l'occupation et elle était loin de s'être remise après la libération de la France. On manquait de tout : pas d'approvisionnement, pas encore de grosses commandes malgré les énormes besoins. Les sociétés étaient dans l'obligation de reprendre tout leur ancien personnel de retour de captivité, mais ce n'était pas de gaieté de cœur qu'elles voyaient arriver ce personnel qui avait perdu la main, il faut bien le dire. C'est ainsi qu'à mon arrivée, je me suis entendu dire que, maintenant, il fallait repartir à zéro. C'est agréable à entendre quand on a 32 ans ! On m'a trimballé au service des Méthodes, puis aux Achats, à l'Outillage ! Manifestement, on espérait que, dégoutté, je finirais par donner ma démission : ce que j'ai fait au bout de deux ans ! Mais, surtout, il régnait, dans la région parisienne, beaucoup plus qu'en province, une atmosphère de délation, de chasse aux sorcières, que je n'avais pas ressenti à Rochefort, et que je supportais mal. Les parisiens avaient la mémoire courte et il leur fallait surtout oublier les quelques dernières années. Considérant que quelques divisions françaises avaient pris part aux derniers combats, qu'un Général français avait été admis aux pourparlers de l'armistice et avait été présent à sa signature, ils se considéraient comme les vainqueurs, oubliant que c'était grâce au matériel qui leur avait été fourni en abondance par les Etats Unis. Et, du coup, nous qui revenions de captivité, nous étions les vaincus qui n'avions pas connu les difficultés de l'occupation ! Sans insister sur cette période qui me fut assez pénible, je veux ici raconter trois incidents qui me sont arrivés. Le premier est plutôt plaisant. Un jour, en tournée avec un de nos représentants, nous sommes rentrés pour nous rafraîchir dans un café. Et j'ai entendu notre représentant commander un « Pétain ». J'ai eu du mal à comprendre qu'il demandait ainsi un vieil Armagnac (un vieillard maniaque). J'ai dit que, après mon retour, Pierre Goutet, Commissaire National des Scouts de France pour la Route, m'avait désigné comme assistant de la branche auprès du Commissaire de Province du Vieux Loup. A ce titre, j'étais chargé d'un certain nombre de sessions de formation des chefs de clan et de leurs adjoints. Or, pendant l'occupation, avait été créée, à Uriage, une Ecole des Cadres dont l'essentiel des formations avait pour base les méthodes scoutes ; et l'Ecole d'Uriage avait publié quelques excellents fascicules qui résumaient la formation qu'elle donnait. Evidemment, j'ai utilisé ces fascicules au cours de mes sessions de formation. Et un jour, un des routiers présents m'en a fait de vifs reproches : du moment que cela venait du temps de Vichy, peu importait que cela ait de la valeur ou non, c'était bon à mettre au pilori ! Le troisième incident que je vais maintenant rapporter, m'a beaucoup plus touché parce qu'il a eu lieu dans la famille. Les Stoeckel avaient passé l'année de la guerre et les premiers mois de l'occupation à Royan ; ils n'avaient donc pas assisté à l'exode qui avait jeté sur les routes ces colonnes lamentables des réfugiés du Nord et de la Belgique. Ils n'étaient revenus à Boulogne qu'après l'armistice. A Royan, ils s'étaient liés avec une autre famille de réfugiés qui habitait près de chez eux et dont plusieurs enfants avaient le même âge qu'eux : ils se revoyaient souvent à Boulogne. En 45, c'était l'euphorie de la victoire : les deux familles recevaient des jeunes américains ; je me suis même laissé dire que l'ainée des sœurs de la famille amie était plus ou moins fiancée à un américain. Bref on ne jurait que par les Américains. Comme je l'ai dit, j'habitais maintenant rue Erlanger, près de la Porte de Saint Coud, à une vingtaine de minutes à pied de chez les Stoeckel et, très souvent, quelquefois plusieurs fois par semaine, j'allais dîner à Boulogne. Un soir, je ne sais plus à quelle occasion, la conversation est venue sur la guerre et la débâcle de 40. Et là, mes nièces se sont déchaînées : l'armée française avait été au dessous de tout, n'avait pas su défendre la France ; c'est tout juste si elles n'ont pas dit que cette captivité, nous l'avions bien mérité. Et je ne pouvais rien répliquer, je n'avais pas droit à la parole : j'étais l'un de ces minables, l'un de ces parias, responsables de cette situation ! J'ai fini par m'en aller en claquant presque la porte et je suis rentré chez moi. Quelques minutes plus tard, on a sonné. C'était Jean-Pierre qui venait me dire qu'il me comprenait et presque présenter des excuses pour sa famille ! Je n'ai jamais su s'il avait fait cette démarche de lui-même ou à l’instigation de sa mère et de ses sœurs qui avaient compris qu'elles étaient allées peut-être un peu trop loin. Car, évidemment, il n'a jamais plus été question de cette affaire ! Heureusement, cette période n'a duré que quelques mois avec cette alternance de joies du retour à une vie normale et ces déceptions quelquefois douloureuses ! |