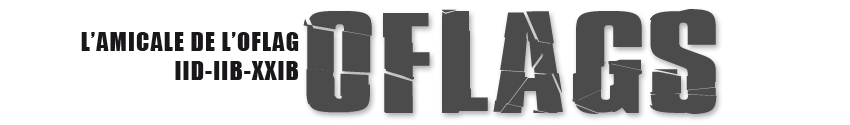L'Histoire
Ecrire une histoire de la captivité est pratiquement impossible, même si l’on se borne à celle d’un seul camp et à plus forte raison celle d’un camp d’officiers prisonniers.
En fait, si l’on demandait aux trois mille officiers qui ont vécu la plus grande partie de leur captivité à l’Oflag IID-IIB, d’écrire ce qu’ils ont vécu, nous aurions trois mille récits différents, et souvent très éloignés les uns des autres. Nous avons tous connu des camarades qui ont pratiquement passé leurs cinq années, allongés sur leur couchette à ruminer leur malheur, alors que l’agenda personnel de leur voisin de chambre ne comportait pas de blanc, rempli qu’il était par des cours, des conférences, des répétitions ou des services rendus à l’échelon
de la chambre, du bloc ou du camp. Tous ces récits n’auraient que quelques points communs, les événements importants qui ont marqué fortement la vie de chacun et qui ont agi sur l’ensemble des activités du camp.
Ce sont ces événements que nous allons évoquer maintenant, sans prétendre à une chronologie détaillée que nous essaierons d’ailleurs d’établir et que l’on trouvera à la fin de cet ouvrage.
Nous avons signalé que les arrivées du camp de Grossborn s’étaient succédées du 20 juin I940 au milieu de juillet. Dès le 23 juillet, au bloc III, le premier occupé, les catholiques pouvaient assister à une grande messe
en plein air. Les premières journées ont été consacrées aux formalités de fouilles, d’immatriculation et d’épouillage ainsi que par les installations dans les différentes baraques. Mais, très rapidement, certains officiers se sont préoccupés de meubler leurs loisirs forcés et d’apporter à leurs camarades de captivité les ressources de leur savoir et de leurs compétences. C’est ainsi que le 1er juillet, dix jours à peine après l’arrivée des premiers contingents, naissait l’Université de l’Oflag IID. Le commandant Baticle, second Recteur de cette Université, nous en raconte la naissance :
"Le Recteur. "C’est un titre que j’ai pris, ou qui m’a été donné (je ne me rappelle pas très bien) un certain jour de décembre 1940 au départ du commandant Rivain, et que j’ai cédé sans trop de regret le 6 août 1941, lorsque ma qualité d’ancien combattant de 1914-1918 m’a valu une libération anticipée. Dans notre bon pays de France, quand il y a un Recteur, c’est qu’il y a une Université. Il a donc existé à Grossborn d’abord, à Arnswalde ensuite, une Université de captivité, assez originale, dans sa création, dans son organisation, dans la composition du corps professoral comme du corps estudiantin. "Quelques jours après le début de ma captivité, au cours de la longue randonnée qui devait nous conduire du moulin de Laffaux à Westphalenhof (*), nous nous étions arrêtés 48 heures à Gedinne, en Belgique, à quelques kilomètres de notre département des Ardennes. J’eus l’occasion de faire connaissance avec un chef d’escadron de cavalerie, le commandant Rivain, officier de réserve comme moi, qui me déclina ses nom et qualité : Directeur de la "Nouvelle Revue Française" : je lui déclinai les miens : Professeur d’histoire en classe de Saint Cyr au lycée Saint Louis.
"Et il me proposa aussitôt, quand nous serions arrivés à notre destination définitive, d’organiser des conférences de littérature et d’histoire, moins pour instruire nos camarades que pour leur donner
(et à nous aussi) une occasion de tuer le temps. Entreprise bien modeste mais qui allait vite prendre corps.
"A peine, en effet, étions nous arrivés, à l’aube du 21 juin, en gare de Westphalenhof, après quelques jours passés à Trêves et à Mayence, après avoir traversé le Rhin, l’Elbe et l’Oder, que quelques officiers, membres
de l’Université, réunissaient leurs camarades de baraque pour de petites causeries concernant leur spécialité. "L’ayant appris, le commandant Rivain voulut co-ordonner ces initiatives : le 28 juin, une réunion des universitaires se tint pour mettre au point un embryon d’organisation ; c’est là que je fis connaissance avec Ratinaud, Daniel Robert, historiens et géographes, Marcel Robert et Zink, professeurs d’allemand, Kuntzmann et le chamoine Lainé, professeurs de mathématiques. Et le 1er juillet, à 17 heures, étant à la fois le doyen d’âge, le plus ancien des universitaires présents et le seul officier supérieur, j’eus le grand honneur de monter dans ma chaire (en réalité, j’étais assis sur une chaise, avec une petite table devant moi, au ras du sol) et, devant 300 camarades, assis sur leur petit tabouret, je commençai mon cours (à cette date, dans l’Université de France, c’était le moment ou on les terminait, mais ce monde de captivité était vraiment un monde à l’envers ! )".(19)
Nous reviendrons plus loin sur les différentes activités qui ont meublé notre séjour derrière les barbelés,
mais notons aussi des maintenant que le 28 juillet, Chaline donnait un récital de piano, que des séances récréatives étaient organisées... et que la première tentative d’ évasion se situe le 10 août. Au début de septembre, les Aspirants ont quitté le camp pour être regroupés dans un camp spécial en Prusse Orientale.
Le 29 septembre dans la grande salle de la cantine - dont nous aurons l’occasion de reparler - un premier spectacle de théâtre - malgré toutes les imperfections dues à l’improvisation - était monté.
Dans cette revue rapide des événements, il nous est impossible d’énumérer tous les spectacles, récitals de musique ou compétitions sportives qui se sont succédé, pas plus d’ailleurs que les quelques visites de délégués de la Croix Rouge ou de la mission Scapini... et les tentatives d’évasion. Le 2 novembre paraissait le premier numéro du premier journal du camp, baptisé le "Ballon Captif’ et qui, à l’origine se voulait essentiellement
un journal sportif.
En janvier 1941, onze aumôniers militaires sont rapatriés, seul nous reste au camp l abbé Dupaquier qui refuse de partir. Le samedi 1er février, une évasion réussie, celle du capitaine Billotte, accompagné du capitaine de Person et du lieutenant Richemond.
Le 19 mars, le journal local que nous pouvions recevoir au camp : la "Pommersche Zeitung", annonce le jugement et la condamnation à mort de l’ancien cantinier du camp, Schmidt (*), qui s’était fait une fortune en nous vendant - à des prix d’ailleurs exorbitants - de quoi améliorer un ordinaire déficient, et satisfaire les fumeurs. Schmidt méritait ainsi toute notre reconnaissance. Les débats du tribunal ont duré quatre jours : ils avaient été précédés d’une enquête faite au camp le 14 février précédent.
Le 19 mars, le journal local que nous pouvions recevoir au camp : la "Pommersche Zeitung", annonce le jugement et la condamnation à mort de l’ancien cantinier du camp, Schmidt (*), qui s’était fait une fortune en nous vendant - à des prix d’ailleurs exorbitants - de quoi améliorer un ordinaire déficient, et satisfaire les fumeurs. Schmidt méritait ainsi toute notre reconnaissance. Les débats du tribunal ont duré quatre jours : ils avaient été précédés d’une enquête faite au camp le 14 février précédent.
Le 21 mars 1941, alors que jusque-là les blocs étaient isolés, les allemands acceptent que les portes en soient ouvertes et que les prisonniers puissent circuler d’un bloc à l’autre sans avoir besoin d’un laissez-passer.
Nous pouvons désormais aller voir des amis dans un autre bloc ; et surtout, pour les grands marcheurs,
nous pouvons faire le tour complet du camp ce qui représente une bonne demi-heure de marche.
Cette ouverture des portes a pour conséquence l’unification des Universités. Bien entendu, à la nuit,
les blocs sont à nouveau isolés.
Le 27 mars, au cours d’une promenade en foret, les lieutenants Branet et de Boissieu, accompagnés du Sous-lieutenant Klein, réussissent à s’évader en direction de la Russie. Dimanche 22 juin, depuis quelques jours, un nombre anormal de convois empruntait la ligne de chemin de fer qui passe devant le camp : nous apprenons donc avec moins de surprise l’attaque allemande contre la Russie.
Le 27 mars, au cours d’une promenade en foret, les lieutenants Branet et de Boissieu, accompagnés du Sous-lieutenant Klein, réussissent à s’évader en direction de la Russie. Dimanche 22 juin, depuis quelques jours, un nombre anormal de convois empruntait la ligne de chemin de fer qui passe devant le camp : nous apprenons donc avec moins de surprise l’attaque allemande contre la Russie.
En août, nous constatons la création d’un camp de prisonniers russes à l’ouest et près de notre camp.
Le cimetière de ce camp est contigu à celui où reposent déjà quelques uns de nos camarades.
Déjà, de loin, à l’arrivée en gare des convois de prisonniers russes, nous avions pu constater que, de chaque wagon, on sortait un nombre anormal de cadavres. Mais de plus, chaque jour, à partir de ce moment, les promeneurs pourront assister à un spectacle révoltant. .. Je laisse la parole à notre camarade Ratinaud :
"Sur le chemin qui traversait le petit bois, apparut un tombereau cahotant précédé par une sentinelle en armes, conduit par un prisonnier russe. Il était plein de cadavres nus dont les membres semblaient plus décharnes encore que ceux des squelettes. lci pendait une main livide, ailleurs un pied, ailleurs encore une tête aux yeux morts, énorme. Tout cela ballottait sinistrement au pas du cheval, un cheval poméranien aux poils longs. Sur le tas, à même les morts, s’était assis un autre prisonnier russe, à peine moins pale et maigre
que les cadavres. Il mangeait une tartine mince de pain noir, sans doute le salaire de sa triste besogne.
Epouvantés, les deux français ne pouvaient détacher leur regard du spectacle. La charrette s’arrêta.
Le conducteur descendit et, avec l’aide de son camarade, rabattit le côté du tombereau. Le tas de cadavres glissa dans une fosse ouverte. Il y eut un bruit cascadant et mou, celui de corps dégringolant.
La sentinelle fumait une cigarette, en surveillant avec ennui la manoeuvre. Les deux russes saisirent alors
à ses deux extrémités un sac et déversèrent le contenu sur les cadavres. Une fine poudre blanchâtre.
Puis, à grands efforts, ils recouvrirent le tout de sable. Ils remontèrent dans le tombereau et reprirent
le chemin en sens inverse. "(20)
Ce spectacle se reproduisait chaque jour pendant plusieurs semaines. L’émotion dans le camp était grande
et quelques manifestations se sont produites près des barbelés qui longeaient le camp de ce côté.
Après avoir menacé de tirer sur ces attroupements, les autorités allemandes furent obligées de donner des explications et de justifier leur conduite dans un communique public le 17 septembre. Les enterrements de russes ne se firent plus en vue du camp.
En décembre 1941, fut crée au camp un cercle Pétain. Le mois de mars 1942 a été marqué pour le camp par une suite d’événements qui ont fortement altéré les relations entre prisonniers et leurs gardiens.
A partir de la baraque 35 du bloc I, baraque relativement proche des barbelés, un tunnel est construit qui émerge à l’extérieur du camp, au nord. Plusieurs équipes de quatre ou cinq doivent l’emprunter à partir
du 16 mars. Le 16 et le 17, tout se passe comme prévu. Mais le 18 ... laissons à i’abbé Flament et à Roger Ikor le soin de raconter les journées suivantes :
Le 18 mars, à 21 heures, à la sortie du tunnel, le lieutenant Rabin essuie des coups de feu.
Transporté jusqu’à l’infirmerie du camp, l’abbé Dupaquier s’y rend aussitôt ; les allemands voulurent sortir l’aumônier de force ; celui-ci résiste. Par deux fois, il fait redire aux allemands par l’interprète français,
le capitaine Duhr, qu’il est là en vertu du droit le plus strict ; il ne sortira qu’une fois son ministère accompli. L’aumônier tient bon et finit par vaincre la résistance allemande. "La plaie une fois découverte, les huit allemands s’éclipsent et laissent le blessé aux mains des français, médecins, infirmiers et aumônier.
Les médecins pratiquent des piqûres d’huile camphrée et de morphine, font un pansement provisoire.
L’aumônier administre notre camarade. A 2 heures du matin, le 19 mars, Rabin est évacué vers l’hôpital d’Hammerstein. Il y mourra immédiatement après une intervention chirurgicale tentée de toute urgence." (21) le 19 mars 1942 - La nuit précédente, notre camarade Rabin a été assassinéédans les conditions
que j’ai dites. Les officiers de son bloc ont demandé à leur chef, le colonel .. une minute de silence à l’appel.
Refus de ce monsieur ; aussi quand il commande son garde à vous à l’arrivée des allemands, personne n’obéit.
Grande fureur, menaces, mais oui, de conseil de guerre. Là-dessus, un capitaine, du Crest, sort des rangs
par derrière, commande garde à vous, puis demi-tour ! Les deux mouvements exécutés à la perfection,
le bloc se retrouve le dos à son chef français et au capitaine allemand Barr, venu recevoir l’appel.
Du Crest rappelle alors en deux phrases "le lâche attentat commis sur notre camarade grièvement blessé" ; puis commande une minute de silence. Elle est religieusement observée, le dos aux officiers, blancs de rage, tandis que du Crest est embarqué à grands coups de crosse ». (22) ... Au bloc III, l’officier allemand est incapable de faire compter les officiers. Il tente une démarche auprès du colonel Vendeur pour obtenir le silence, la mise en rangs et le contrôle. C’est en vain ; des cris se font entendre : "Assassins ! ". "Le colonel Vendeur poursuit son enquête : les allemands ne se sont pas contentés de tirer sur le premier sorti, ils ont déchargé des rafales dans la cage d’escalier du tunnel ; une valise, tout au fond, a été transpercée de plusieurs balles. "Le 21, au rapport, on nous transmet les précisions suivantes : les allemands se sont rendus compte de l’indignation qui régnait dans le camp ; depuis plusieurs jours, à l’appel, les sentinelles viennent en armes.
Le capitaine Bahr ne sourit plus. Le colonel français maintient les mesures prises ; suppression des relations "amicales" entre allemands et français, fermeture de la bibliothèque allemande, suppression des cours d’allemands, suppression du cinéma allemand. Mais il n’est pas d’avis d’interdire pour autant toute activité
et toute vie dans le camp.
Le lundi 23 mars, tandis que le corps est enseveli au cimetière français d’Hammerstein, un service solennel est célèbre à la cantine du bloc II à la mémoire du lieutenant Rabin. Foule énorme jusque hors de la cantine : chorale des quatre blocs. Rusher qui essaie d’entrer dans la salle se trouve bloqué dans le tambour à droite
de la scène. L’aumônier Dupaquier célèbre la messe." (23) Depuis ce moment, les rapports se tendent manifestement entre les états major français et allemand du camp. Les allemands essaient de justifier leur geste sans y parvenir. D’ailleurs, le 11 avril suivant, on apprend le départ du capitaine de vaisseau Schulz,dit "l’Amiral" qui commandait le camp.
Un autre événement va modifier durablement les relations avec l’autorité allemande : l’évasion le 17 avril du général Giraud, mais nous n’en subirons les conséquences que plus tard, dans notre nouveau camp. A la fin du mois, nous avons la certitude que le changement de camp est imminent. On a fait une répétition le 29 avril, suivie d’une fouille générale le 30.
Un autre événement va modifier durablement les relations avec l’autorité allemande : l’évasion le 17 avril du général Giraud, mais nous n’en subirons les conséquences que plus tard, dans notre nouveau camp. A la fin du mois, nous avons la certitude que le changement de camp est imminent. On a fait une répétition le 29 avril, suivie d’une fouille générale le 30.
Le 14 mai, les prisonniers des blocs II et III sont entassés dans les deux autres blocs, et, en fin d’après-midi, nous voyons arriver un premier convoi des officiers polonais que nous allons remplacer à l’Oflag IIB,
à Arnswalde. Voici le récit du capitaine Arnoult, cité par Yves Durand :
"Arrivée mémorable : le train aux wagons bien connus, soigneusement fermés, vient se ranger lentement ;
des sentinelles l’entourent ; le long de la petite route qui conduit au camp, des soldats armés se tiennent sur les talus, tous les quinze mètres. La colonne kakie avance lentement, fortement encadrée, quelques officiers allemands en tête. Déjà nos clameurs les ont salués, mais les premiers rangs ayant dépassé les bâtiments
du corps de garde, nous nous portons vers la porte barbelée, ce qui nous permet d’approcher les arrivants
à vingt cinq mètres.
Quelques camarades ayant appris un chant d’accueil en langue polonaise, les choristes improvisés l’entonnent à pleins poumons, à la surprise émue des polonais et à la fureur des allemands. Les premiers répondent par gestes à nos "Vive la Pologne" ; puis répondent des "Vive la France (*)" ; mais les gardiens les refoulent rapidement vers l’entrée du bloc III.
Le lendemain, vers 10 heures, nous nous rassemblons en tenue de départ, par groupes de quarante.
Apres une longue attente, la colonne s’ébranle. A ce moment, nous apercevons des officiers polonais qui,
en dépit des "Verboten (**)" impérieux, se sont massés en silence entre deux baraques. Soudain, une douzaine d’entre eux s’alignent et placent sur leur poitrine un rectangle blanc ; sur chaque rectangle une lettre se détache et l’ensemble forme "Vive la France". Ils nous rendent ainsi notre salut de la veille.
Une formidable acclamation jaillit de nos rangs ; nous agitons les mains, sans nous soucier de nos gardiens littéralement fous de rage ; le grand escogriffe qui se trouve près de moi, croise la baïonnette et me l’approche de la poitrine en vociférant. Quand nous nous retournons, les polonais ont disparu et des sentinelles cernent nos anciennes baraques.
"La veille, des officiers français avaient assisté, impuissants et la rage au coeur, à l’action répressive entreprise par les allemands à la suite de la manifestation d’accueil des polonais ; les gardiens étaient intervenus, revolver au poing, accompagnés de chiens pour refouler les polonais vers les baraques."(24)
C’est ainsi que, par un chassé-croisé de quatre jours, l’échange des camps fut fait :
Le 14 mai - arrivée du premier contingent polonais. Le 15 - départ du premier contingent français (blocs II et III). Le 16 - arrivée du deuxième contingent polonais. Le 17 - départ des derniers français de Grossborn (blocs I et IV). L’installation dans le nouveau camp a demandé deux jours après réajustements et quelques modifications des groupes.
L’affaire Rabin s’est traduite par quelques sanctions. Sept officiers dont l’attitude avait été remarquée assez violente, sont condamnés à quelques jours de prison. Le 25 mai 1942, les allemands décident de la mise en application de sanctions contre les officiers prisonniers à la suite de l’évasion du général Giraud.
La première de ces sanctions sera la suppression et la confiscation des bibliothèques qui ne nous seront pas rendues après leur transfert depuis Grossborn.
C’est à cette époque que les allemands commencent à faire passer quelques notes proposant à des officiers volontaires un travail en Allemagne. Ces notes ont eu assez peu de succès. Mais, dans sa thèse, l’abbé Flament signale tout de même 158 volontaires en août 1942 et 174 en juin 1943 (***). Les sanctions Giraud ont été légèrement assouplies par la suite puisque les répétitions théâtrales ont pu reprendre ainsi que les cours d’allemand ; mais les livres confisqués ne nous ont été rendus qu’au début de novembre 1942 et la bibliothèque générale n’a pu être rouverte que le 23 novembre. Tout l’été 1942 a donc été marqué par une nette diminution des activités habituelles qui n’ont repris que petit à petit. Le 30 août, nous avons accueilli une centaine de camarades qui venaient du camp de Schubin.
Les événements de novembre 1942 : débarquement en Afrique du Nord puis occupation de la zone libre en France, n’ont pas été marqués au camp par des manifestations particulières. Au début de décembre 1942, a commence à circuler dans chaque chambre un bulletin d’information résumant les nouvelles recueillies par quelques camarades au moyen de postes de radio clandestins dont nous aurons à reparler. Très vite, ce bulletin d’information, connu et très apprécié sous les initiales I.S.F. : traduisez : -Ils Sont Foutus ! C’est aussi à cette époque, exactement le 14 novembre, que le Centre d’Entraide a pu mettre en place l’organisation de la cuisine collective dont nous avons parlé. Il y a peu de choses à dire de l’année 1943 sinon qu’elle s’est déroulée un peu dans la monotonie, ponctuée pour les prisonniers que nous étions par des concerts, des représentations théâtrales particulièrement réussies (nous en parlerons plus loin) et quelques expositions préparées par les différents groupes du camp.
En juillet, quelques privilégiés ont profité de quelques promenades en dehors du camp, dont le principe avait été repris mais qui ont été assez rapidement arrêtées. En fait, elles n’ont duré que jusqu’au début du mois d’octobre. Le 22 août, nous sont arrivés deux cent quarante camarades venant du camp de Schoken et qui ont apporté un sang nouveau à l’ensemble du camp et nous en reparlerons aussi. En février 1944, nous avons eu la peine de perdre notre doyen, le colonel Rousseau, dont tous ont gardé un grand souvenir, qui est mort d’épuisement à l’hôpital de Stargart. Il a été remplacé par le colonel Malgorn, qui, à plusieurs reprises,
a dû céder la place de doyen à des colonels, plus anciens que lui et qui nous arrivaient venant des camps en partie regroupés avec le notre. Par exemple, en mai 1944, nous sont arrivés deux cent cinquante nouveaux camarades évacués du camp de Montwy, dont le colonel Finiels qui prend les fonctions de doyen avant d’être envoyé au camp de Lübeck le 22 juillet 1944.
Juin 1944, le débarquement de Normandie est annoncé par ISF dès le 6 juin. Cet événement est marqué par nous avec une certaine solennité donnée à l’appel. C’est là, la première fois, que nous adoptons cette forme de manifestation. Mais la technique s’en affinera et désormais, nous soulignerons ainsi chaque étape de la guerre. Le 14 juillet, ce fut aussi une autre forme de manifestation ; avait été annoncée, dans la grande salle de gymnastique, la Turnhalle, une séance récréative dans l’après-midi sur le thème de la chanson française. Tout d’un coup, trois de nos vedettes "féminines", vêtues l’une de bleu, les autres de blanc et de rouge se retrouvèrent au milieu de la scène. Dans l’enthousiasme, le public debout a entonné une vibrante Marseillaise qui ne fut pas du tout appréciée par nos gardiens, obligés de quitter la salle, furieux. Nous nous attendions à des sanctions. La seule que nous ayons eue a peut-être été le départ, huit jours plus tard, du colonel Finiels, alors doyen, pour le camp de représailles de Lübeck. Les appels solennels que nous avions expérimentés à l’occasion du débarquement de Normandie se sont reproduits deux fois au cours du mois d’août : d’abord, à l’occasion du débarquement en Provence le 15 août, mais surtout pour la libération de Paris, le 25 août.
Henri Grellet raconte :
"Le décor de l’appel est immuable : une cour rectangulaire flanquée sur sa longueur par des bâtiments à quatre étages, sur sa largeur par le hall où se tiennent les offices religieux et les jeux sportifs, et de l’autre coté, par les bureaux de la Kommandantur. Dans la cour, sur cinq rangs sont alignés les 3 000 officiers du camp. "Le cérémonial est le même : les deux officiers allemands qui ont la responsabilité de l’appel, franchissent la petite porte du camp, se dirigent vers le centre, au point de rencontre des diagonales. Le colonel français nous met au garde à vous ; un échange de saluts suit, puis "Trompe la mort" et la "Frégate" (*) reviennent au point de départ, arpentant en sens inverse les deux cotés du rectangle où la vérification des effectifs se fait par groupe de 100, mis l’un après l’autre au "garde à vous" avant le passage du vérificateur. Ce contrôle donne
un aspect "rond de cuir" à une opération qui eut pu être martiale : files et rangées ne sont pas droites ;
la tenue vestimentaire est tout sauf réglementaire ; le "garde à vous" n’est pas unanime, l’appel n’en finit plus : il devient laborieux quand on récapitule les comptes, ou qu’on vérifie dans une chambre du camp,
dans une cave ou à l’infirmerie la présence d’un camarade en moins ou en plus.
Le 25 août 1944, la radio nous apprend la libération de Paris. Tout n'est pas encore clair, les escarmouches se poursuivent, mais la ville est intacte, l'hôtel de ville pavoise, et de Gaulle descend les Champs Elysées.
II est possible qu'on ait anticipé sur l'événement, que la chronologie n'ait pas été respectée ; nous faisons comme si Paris était vraiment libéré. Cette prise de position est significative de notre impatience et de notre conviction qu"ils sont foutus". "Aucun ordre n'est donné : ça n'est pas dans les manières, un mot d'ordre seulement, transmis par ISF, de nous présenter au prochain appel en tenue n° 1. Très elliptique cette recommandation, sans trop d'illusion en raison de l'état de notre garde-robe. Chacun fait de son mieux, déniche la brosse du clochard pour secouer le vêtement et les chaussures ; des ceinturons camouflés depuis toujours réapparaissent ; quelques cravates ornent la silhouette des plus huppés. "L'habit fait le moine, si bien que chacun est mûr pour l'office, dans sa rangée et dans sa file ; on se croit tous à une prise d'armes en attente de la visite du général ; personne ne bouge. La spontanéité des réactions unanimes est telle qu'on est soi-même surpris par l'ordre et le silence. "Arrivent "Trompe la mort" et "la Frégate". Ils entrent dans le carré sans la moindre arrière pensée, pas encore prévenus de l'immense nouvelle, et s'en vont de leur pas habituel, mécanique, vers notre colonel. Le trajet est long, une bonne cinquantaine de mètres ; c'est suffisant pour percevoir que l'atmosphère est bizarre ; aucun bruit, le silence total .... "Leur démarche s'en ressent.
Le colonel est en tenue, comme à l'ordinaire. II se met au garde à vous, comme à l'ordinaire, puis nous adresse le même commandement ; sans bavure, on entend claquer 3 000 talons. Echange de saluts. J'aurais aimé voir les visages de nos gardiens .... "Repos ! "Le repos est un commandement ; on obéit à l'ordre en laissant le talon droit en place, toujours immobiles... Nos deux officiers commencent à subodorer qu'il se passe quelque chose, mais quoi ? Parcourant la diagonale qui les conduit au départ de leur périple, à nouveau leur démarche trahit leur émoi : finie l'inspection débonnaire ! Pour un peu, ils frissonneraient comme un chien qui pressent le tremblement de terre ; ils feraient demi-tour s'ils le pouvaient. Mais ils sont embarqués, alors ils foncent. .. Devant chaque centaine, le même claquement unanime, la même ordonnance, le même silence et 200 yeux qui vous scrutent. Ils se sentent décontenancés, déshabillés, ridicules. Que peuvent-ils dire ? Rien.
Que peuvent-ils faire ? Pas grand chose sinon presser le pas. "La Frégate" ne sait plus ou donner de la gîte,
elle subit la houle de fond, fait effort pour rester digne, ne pas embarquer, se redresser sans trop craquer : l'accélération seule peut la maintenir en relatif équilibre. Et chaque fois, la centaine nouvelle à aborder ; cet ordre à affronter, ce silence, ces talons qui le rompent en claquant comme un coup de fouet, l'impressionnent au point qu'il en oublie de rendre le salut une fois le carré dépassé ...Il ne sait plus ou il en est ; il est catapulté d'un groupe sur l'autre, comme si, à chaque passage nouveau, il recevait 100 coups de pied dans le cul.
A-t-il le sang froid de remarquer qu'en diagonale, de l'autre côté, "Trompe la mort" manque de s'affaler...
La marche au supplice se poursuit dans le même silence effrayant. Que viennent-ils faire dans cette galère ?
Que peuvent-ils faire ? Compter, il n'en est plus question. Compter des diables d'autant plus inquiétants qu'ils sont immobiles. Mais qu'ils foutent le camp, ces démons ! Qu'on leur ouvre les portes, qu'on en finisse ! "En plein jour, ils s'élancent comme dans la nuit, sans voir personne. Le colonel, au centre du terrain, est leur salut, la bouée de sauvetage. Ils font l'effort de saluer après l'ultime fracas des talons. Puis c'est la panique. Sauve qui peut. Comment sont ils partis ? Comment sont ils sortis ? Au pas de l'oie, sous les huées ! Personne n'a daigné les regarder. Nous attendons pour faire mouvement qu'ils aient vraiment c'est la panique.
Sauve qui peut. Comment sont-ils partis ? Comment sont-ils sortis ? Au pas de l'oie, sous les huées !
Personne n'a daigné les regarder. Nous attendons pour faire mouvement qu'ils aient vraiment disparu "(25)
Plus concis, Félix Mallet de Loz fait également allusion à la même scène : "jusqu'en janvier 1945, notre vie fut certainement celle des autres Oflags, vie racontée depuis, en long et en large ; rien de vraiment extraordinaire, sinon la surprise des allemands à l'appel du 25 août 1944.
Ce jour là, contrairement à l'habitude, les officiers prisonniers étaient rassemblés dans la cour cinq minutes avant l'heure, tous en rang, revêtus de leur plus bel uniforme. A l'arrivée des officiers allemands, silence absolu, tout le monde au garde à vous. Les gardiens compteurs étaient désorientés ; ils pressaient le pas, baissaient le regard, ils étaient accablés, cernés par ce silence solennel et pesant auquel ils ne pouvaient échapper, un silence comme un immense remords. Quand ils passaient tout près de nous qui les regardions, muets et raides comme la justice, ils avaient l'air de condamnés. En moins de dix minutes, tout était terminé. Comme un malfaiteur, le capitaine salua notre colonel et disparut rapidement sans comprendre (il a compris bien vite) la raison de cet appel exceptionnel. Nous avions voulu donner un comportement très symbolique à cette cérémonie, car nous venions d'apprendre par nos radios clandestines, celles qui chaque jour nous donnaient par ISF (ils sont foutus), les nouvelles de la situation des belligérants, que, le 24, le général Leclerc était entré dans Paris et que, le 25, les allemands avaient signé la fin de l'occupation de notre capitale, sans dommages importants"(26).
A partir de cette cérémonie mémorable, nous avons vécu ce qui a été pour la plupart d'entre nous, les six mois les plus pénibles de notre captivité. Toutes les relations avec nos familles étaient pratiquement coupées.
Ce qui veut dire l'interruption à peu près totale de la correspondance et de l'envoi des colis qui représentaient la plus grosse partie de notre subsistance. L' abbé Flament écrit alors : "Les pesées mensuelles accusent une courbe régulièrement descendante. Sauf rares exceptions, les prisonniers qui vont prendre la route de l'Ouest le 29 janvier 1945, ont perdu le tiers de leur poids de 1940 ; un peu moins du tiers pour les petits de taille
et les organismes d'épargne ; plus du tiers pour les plus grands et les organismes de dépense"(27).
Le 15 octobre, les allemands décident la suspension du paiement des soldes versées jusqu'ici en Marks de camp. Dès le 17 octobre, en conséquence, le Centre d'Entraide va créer un nouveau service : une banque qui consignera les sommes ainsi dues à chacun des prisonniers de l'Oflag, afin de leur permettre, à leur retour en France, de faire valoir cette créance. Nous verrons le sort qui a été réservé à cette dernière.
Dès le début de janvier 1945, il est de plus en plus question de l'avance des troupes russes. Au cas où celles-ci approcheraient de l'Oder, que deviendra le camp ? Que feront les allemands ? II y a trois solutions possibles :
ou le camp reste sur place même s'il se trouve dans la zone de combat ; - ou il est évacué par chemin de fer ;
ou il est évacué par la route, c'est à dire que les 3 000 prisonniers, à pied, vont venir grossir le flot des réfugiés que déjà nous voyons passer sur les routes voisines du camp.
Cette dernière solution (qui nous paraissait improbable, étant donné l'état de faiblesse dans lequel nous sommes) va petit à petit s'imposer et tout le mois de janvier sera occupé par les préparatifs des uns et des autres pour essayer de supporter au mieux cette nouvelle épreuve qui nous attend. Le 29 janvier 1945,
l'0flag IIB a cessé d'exister. Il s'est transformé en trois colonnes de 900 à 1 000 officiers chacune, mises sur la route vers l'Ouest, avec pour premier objectif un franchissement rapide de l'Oder. Seuls sont restés à Arnswalde, une cinquantaine de malades qui seront libérés par les russes quelques jours plus tard.
Voilà donc quel a été le cadre, le décor de la cage dans laquelle ont évolue 3 000 officiers, un peu plus ou un peu moins selon les quelques départs et les arrivées en provenance d'autres camps ; 3 000 officiers jeunes, actifs, en bonne forme physique, morale et intellectuelle qui faisaient partie de l'élite de la France et qui,
sans qu'ils y aient été pour quoi que ce soit, vont se trouver condamnés pour une période dont nul ne peut savoir quelle en sera la durée, à une épreuve particulière : l'oisiveté, le vide !
Les premiers jours ont été occupés par les interminables formalités de l'immatriculation, des épouillages, des queues sans fin que l'on devait faire pour toucher son maigre brouet, car les allemands exigeaient que chacun se présente personnellement à la cuisine, avec sa gamelle pour toucher sa ration. Puis, ce fut la répartition par chambre, la constitution ou le regroupement des popotes ; encore une fois, les queues à la cantine pour essayer de compléter, par les achats qui étaient alors encore possible, les insuffisances des rations officielles.
Nous avons dit plus haut comment le cantinier a payé de sa tête les bénéfices extraordinaires et frauduleux qu'il avait pu faire sur nous. Mais, du moins, a-t-il emporté dans la tombe, toute notre reconnaissance.
Ce fut aussi la période de la récupération. Nous étions tous plus ou moins épuisés par une campagne qui avait été courte mais intense et par les trajets qui nous avaient amenés de France vers cette Poméranie. Donc, pendant quelques jours nous avons cherché à retrouver nos forces. Mais, à cet age, cette récupération physique a été généralement très rapide. S'est alors posé le problème de l'installation. Il n'est pas évident de trouver les accommodements qui vont permettre de vivre dans la promiscuité de 48 camarades entassés dans un espace aussi restreint ! On a dû se répartir les taches : un chef de chambre, généralement le plus ancien dans le grade le plus élevé, un adjoint, des chefs de popotes. Il a fallu établir un tour de service, car il devait y avoir un officier de jour pour les corvées ... etc. ... Cela a demandé quelques jours, pas trop pénibles, d'autant plus que cela a coïncidé avec la grande période des bobards, plus ou moins alimentés d'ailleurs par la propagande allemande elle-même : la captivité serait très courte, et certainement nous serions chez nous avant Noël ! Mais cela ne dure qu'un temps ; et bientôt nous avons réalisé ce qui nous attendait : une existence sans autre repère que les deux ou trois appels chaque jour... le vide ! Comment allions-nous le meubler ?