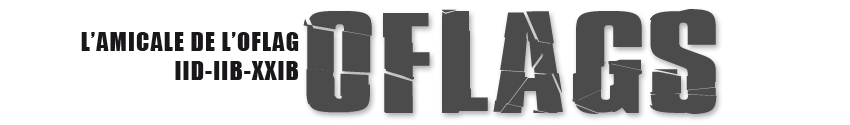L'escalier et la chambre haute |
Ces différentes alertes ne nous empêchaient tout de même pas d’avancer notre tube. Fin février, nous étions à 110 mètres de notre départ et à 8 mètres sous terre. Le sommet de la colline était dépassé ainsi que la deuxième rangée de barbelés et nous devions nous trouver à l’orée des bois. Il restait donc à présent à remonter en surface et à attendre patiemment la fonte des neiges et le dégel de la surface. Nous ne pouvions d’autre part pousser plus avant notre entreprise, car le bois touchait à sa fin et les dessous de baraques étaient presque en totalité comblés. Ce fut donc le moment de procéder à l’escalier final. Pour celui-ci, il fallut une quantité de bois importante, car nous devions boiser les trois côtés et la marche, faire un véritable coffrage pour éviter les éboulements ou les glissements de sable. Autre difficulté : le chariot d’évacuation devait s’arrêter au bas de l’escalier, il fallait donc un équipier supplémentaire, placé entre le boiseur et le « char-man », chargé de transmettre avec ses mains le sable de l’un à l’autre. Enfin, dernière difficulté à surmonter, mais celle-ci la plus grave : le manque d’air se faisait sentir terriblement : une allumette ne brûlait plus, et la respiration était difficile. Allions-nous entreprendre alors de constituer un tuyau de plus de 100 mètres en boîtes de conserve pour amener l’air de notre ventilateur, alors qu’il ne restait plus à creuser qu’une remontée de 10 mètres environ ? Ce travail nous aurait retardés considérablement et nous n’étions pas encore certain du résultat. Cette raréfaction de l’air s’expliquait facilement, car le chariot d’évacuation ne pouvant aller jusqu’au bout à cause des marches, l’air du fond n’était plus brassé et, d’autre part, la montée produisait une sorte de poche où s’accumulait notre lourde respiration empêchant ainsi l’oxygène d’accéder à nous. Nous décidâmes d’un commun accord de nous passer de ventilateur et d’aller ainsi jusqu’au bout, quitte à remplacer l’homme du fond très souvent et à lui attacher les pieds avec une corde, au cas où il perdrait connaissance ; grâce à Dieu, nous n’eûmes pas à employer ce procédé, car notre volonté d’aboutir grandissait à mesure que nous nous rapprochions de l’air libre. Nous mesurions constamment notre profondeur grâce à un long pique-feu qui, en buttant contre la couche glacée, nous indiquait notre profondeur exacte, compte tenu des 50 centimètres environ de couche glacée. C’est ainsi qu’un beau soir, vers le 10 mars, Duhen qui se trouvait à ce moment au fond, nous fait parvenir un petit message écrit à la manière de Christophe Colomb : « Terre », ce qui signifiait que la couche glacée était atteinte et que nous étions à peine à 50 centimètres de la surface, la longueur totale atteignait alors 118 mètres 50. La fin était proche. Grand conseil suprême le soir même, pour mettre au point les dernières mesures de sortie. Il est décidé de constituer, dès le lendemain, la chambre de départ, un petit palier de 1 mètre sur 2 mètres, juste sous la couche glacée et de préparer une sorte de trappe pour reboucher le trou de sortie après chaque départ journalier. Il était entendu, évidemment, que cette couche glacée ne serait percée que le soir même du départ, car il y avait trop de risques de le faire avant, étant donné la dureté et le bruit produit chaque fois qu’on y touchait pour l’entamer. Depuis plusieurs semaines, nous faisions d’ailleurs venir de France, dans nos colis, des « pochettes chauffantes », sorte de poches en papier contenant une sorte de carbure que l’on pouvait échauffer facilement en l’humidifiant. Ces pochettes étaient envoyées par la Croix-Rouge pour réchauffer les pieds des prisonniers. En réalité, nous les accumulions pour nous en servir, le dernier soir, en les appliquant contre la couche de terre glacée ; il devait ainsi être plus facile de la dégeler peu à peu, plutôt que de l’entamer au pic. Notre entreprise ainsi remplie de petites astuces qui nous rendaient chaque fois un grand service. La chambre de départ fut vite constituée dès le lendemain et il fut décidé d’attendre le début de la fonte des neiges pour partir, afin que nos traces dans la neige ne nous trahissent pas. Nous étions au 15 mars. Evidemment, en cas d’alerte ou de menaces de fouille, nous devions jaillir aussitôt, ce qui devait d’ailleurs se produire. Nous ne fûmes pas surpris cependant car nous étions parés depuis longtemps au point de vue vêtements civils, argent, papiers… |